-
- Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECLECO) / Université de Lausanne // Научно-исследовательский центр по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы
-- Patrick SERIOT : «Droit au nom et droit du nom : les Ruthènes sont-ils une minorité ?», Slavica Occitania, Hommages à Roger Comtet, n° 22, 2006, p. 207-233.
[207]
«Pourquoi vouloir que les langues soient des objets aussi purs que les noms qui les désignent ?» (Tabouret-Keller, 2001, p. 343)En utilisant le mot «mosaïque» dans le titre du colloque qu’il organisait à Toulouse en janvier 2005 sur les langues et minorités nationales en Europe centrale et orientale, Roger Comtet ouvrait une boîte de Pandore. En effet, les discussions du colloque ont montré que bien peu de gens s’accordaient sur les définitions des langues et des minorités. Chaque terme était un piège, chaque mot une chausse-trappe.
Les incessantes discussions sur la langue en Europe centrale et orientale, ces réformes de langue, ces normes qui se font, se défont, se modifient, se discutent, se votent, s’adoptent, se rejettent, mettent bien à mal la vision saussurienne d’une langue qui s’impose à une masse «passive» de locuteurs. Mais plus encore, elles posent un grand nombre de problèmes d’ordre théorique à la linguistique: la définition de l’objet-langue, objet spécifique de la linguistique, le problème des limites entre les langues, de la distinction entre le tout et la partie, du continu et du discontinu, le recouvrement des critères de distinction. En fait, il s’agit ici d’un problème des plus classiques lorsqu’il s’agit d’objets tels que langues ou nations : parle-t-on de choses ou bien de mots ? La dispute se déroule-t-elle au plan ontologique ou épistémologique ?
[208]
La «question ruthène» va nous offrir un condensé de controverses qui peuvent donner quelques pistes de réflexion sur la question de savoir pourquoi les langues sont un tel enjeu identitaire dans cette région du monde.1/ Une périphérie au centre de l’Europe
Rappelons brièvement que la chaine des Carpathes qui se trouve actuellement dans l’Ouest de l’Ukraine a longtemps constitué une frontière. Cette montagne ancienne, qui ressemble aux Vosges ou au Jura, est percée de cols qui ont vu passer les Huns (440), puis les Mongols (1241) des steppes d’Asie centrale vers la plaine fertile de Pannonie. Il s’agit d’une région de contacts, de contrastes, de passages, l'exemple même de continuum dialectal bouleversé par des frontières étatiques qui n'ont jamais reposé sur le consentement des populations.
Des langues officielles et normalisées sont en contacts : polonais, slovaque, ukrainien, hongrois, roumain, sans parler d'un nombre difficile à déterminer de dialectes, mais aussi des puissances politiques sont ou ont été en contacts, à différentes époques : la même ligne de crête des cols a fait la frontière entre les parties autrichienne et hongroise de l'Empire des Habsbourg, entre la Pologne et la Tchécoslovaquie, il fut même un temps où la Pologne avait une frontière commune avec la Roumanie (frontière Nord/Sud), puis ce fut au tour de l'URSS d'avoir une frontière commune avec la Tchécoslovaquie (frontière Est/Ouest). Ce changement d'orientation des frontières est illustré sur les cartes suivantes.
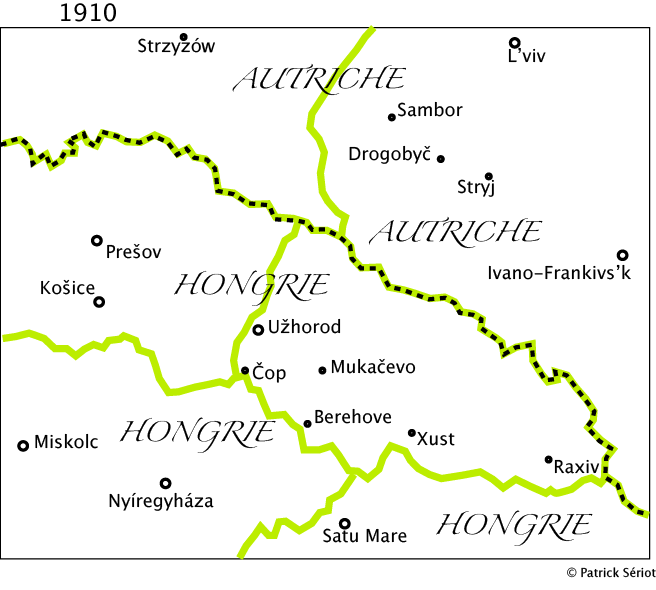
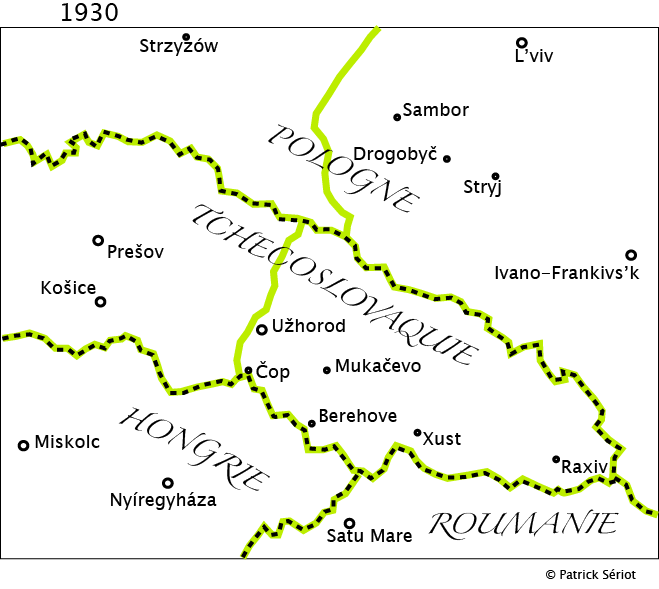
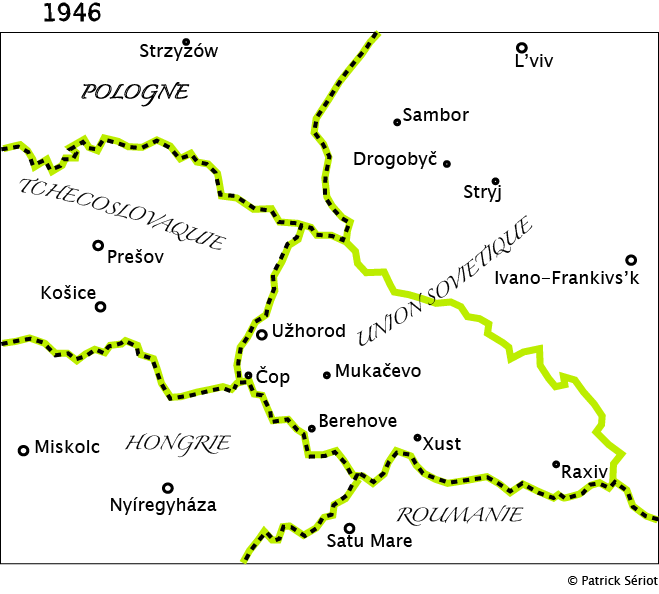
Dès le passage de la région sous souveraineté des Habsbourg au 16ème siècle, les autorités encouragèrent les populations orthodoxes à l’union avec Rome, donnant ainsi naissance à l’Eglise uniate, appelée aussi gréco-catholique, ce qui favorisa une identité collective différente des orthodoxes. Ces uniates parlant des dialectes slaves orientaux furent appelés Ruthenen par les Autrichiens.[1]
[210]
Depuis les réformes de Joseph II à la fin du 18ème siècle, les populations slavophones gréco-catholiques de la région carpathique de l’Empire sont partagées entre trois «orientations nationales» différentes : doivent-elles s’identifier en tant que «Ruthènes», Ukrainiens ou Russes?Un des arguments fondamentaux de cette hésitation identitaire est la «question de la langue».
«L’époque où la question de la langue (jazykovyj vopros) était prédominante fut la plus romantique dans l’histoire de la Sub-Carpathie. Imaginez seulement, partout dans les villes et les villages, dans les salles de lecture, les théâtres, les bureaux de l’administration et les cafés, partout, où qu’il y ait du monde pour parler, on ne faisait que parler, sans cesse, de la question de la langue. Oh, quelle époque c’était ! Quand, par exemple, le temps ne changeait pas pendant des semaines entières et que les gens n’avaient plus de sujet de conversation, il y avait toujours un thème tout trouvé : la question de la langue» (Barabolja, 1929, p. 42-43, cité dans Magocsi, 1987, p. 2).
Dans la République tchécoslovaque de l’entre-deux-guerres, les populations de la «Russie subcarpathique» (Podkarpatská Rus) avaient un statut de «nationalité» intégrante de l’Etat tchécoslovaque, même si l’autonomie territoriale promise par Masaryk ne fut jamais accordée. Elles avaient des écoles, une presse et des organisations culturelles ruthènes. La «question ruthène» fut pendant toute cette période l’objet d’un débat houleux, et la population slave orientale[2] resta divisée.
Après le rattachement/réunification/annexion[3] de la région à l’URSS en 1946, l’affiliation ethnique des Ruthènes fut officiellement bannie, et la population slave orientale de la région des Carpathes «déclarée» ukrainienne. Il en allait de même en
[211]
Tchécoslovaquie socialiste : les livres d’école pour la minorité ruthène étaient importés d’Ukraine soviétique.Mais dès les bouleversements de 1989, des organisations culturelles et politiques ruthènes ont fait leur apparition, réclamant que les Ruthènes soit reconnus comme «nationalité», ou «groupe ethnique à part entière», et puissent ainsi bénéficier de «droits humains collectifs» (Trier, 1998, p. 17).
La situation actuelle a ceci de particulier que, à la différence des Hongrois, Roumains, Juifs, Tsiganes, etc., les Ruthènes ne sont pas «reconnus» comme une minorité nationale au niveau officiel par l’Etat ukrainien, alors que dans d’autres Etats où vivent des Ruthènes, comme la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie et la Serbie, la législation fait une une différence explicite entre Ruthènes et Ukrainiens.
L’idée que les Ruthènes puissent ne pas être des Ukrainiens provoque de grandes réticences de la part des autorités de Kiev, qui voient là une menace sécessionniste d’atteinte à l’intégrité du territoire.
Or la question ruthène a ceci de passionnant qu’on assiste en temps réel à la même entreprise de légitimation d’une langue (et donc des revendications d’une nation) que pendant tout le 19ème siècle en Europe centrale. Mais la différence est que ces discours de légitimation se heurtent maintenant à d’autres logiques, par exemple celle du Conseil de l’Europe.
Un village trilingue (ukrainien / roumain / hongrois) en Ukraine, près de la frontière roumaine.

© Patrick Sériot
[212]
2. Sub- ou Trans-? la désignation comme «point de vue»
Comment parler de ce qui n’a pas de nom, ou trop de noms, sans fabriquer par là-même un référent? C’est le problème de la licorne, tant débattu dans la philosophie scolastique au Moyen-Âge : le nom donne l’illusion de l’être, surtout lorsqu’il est en position de sujet devant un prédicat.
Le risque est que la sémasiologie se donne toutes les apparences d’une onomasiologie, autrement dit, qu’on prétende parler des choses en parlant, en réalité, des mots.
Est-il besoin de rappeler que la langue n’est pas une nomenclature? Toute désignation est un piège, car elle fabrique sa propre ontologie. Ainsi, si l'on parle, comme à l'époque tchécoslovaque, de «Russie Sub-carpathique, (Podkarpatská Rus), on adopte un point de vue tchéco-centré «de l'Ouest», qui voit la région comme un Piémont, en deçà des montagnes. Si en revanche on dit «Ukraine Trans-carpathique» comme à l'époque soviétique puis ukrainienne, on voit la région à partir de l'Est, de l'autre côté de la chaîne. C'est que, au rebours de ce que la philosophie naïvement réaliste nous enseigne, toute nomination est prédication, attribution, ou sélection, d'une qualité.
Les Hongrois disent «Karpatálya». Je propose le néologisme «Carpathie», faute de mieux, qui a l'avantage de ne pas décider d'une orientation géo-politique.
De la langue et de la nation, où est la poule et où est l'œuf?
Le discours sur la langue ici est un va-et-vient entre deux positions différentes :
1) les langues sont des objets naturels
2) les langues sont des objets à construire
autrement dit, il y a confusion constante de l'être et du devoir être.
Ainsi, le 27 janvier 1995, les normes d'une langue littéraire ruthène de Slovaquie ont été officiellement adoptées, avec l'accord des autorités slovaques, lors d'une cérémonie où étaient présents le linguiste américain Joshua Fishman et des représentants d'organisations comme le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme ou la Maison des pays (France). Ce jour-là, comme l'écrivait P. Magocsi, «a new Slavic language is born». Cette codification était le fruit du travail conjoint d'écrivains, d'instituteurs et de grammairiens, rassemblés au sein de l'Institut de la langue et de la culture ruthènes, sous l'égide la Société pour la renaissance ruthène en Slovaquie. Un manuel d'orthographe : Pravyla
[213]
rusyns'koho pravopysu[4] est paru aussitôt après, ainsi que des livres d'école. [5]Cette codification a immédiatement déclenché une réaction indignée des Ruthènes de Slovaquie ayant opté pour une «orientation nationale» ukrainienne ainsi que de la presse d'Ukraine voisine, qui y voyaient un «processus anti-ukrainien, obscurantiste», ne pouvant aboutir qu'à une assimilation aux Slovaques. Un argument fréquemment utilisé dans cette campagne contre la codification était que «la langue ruthène n'avait jamais existé et ne pourrait jamais exister», une paraphrase ironique de la célèbre affirmation du Ministre Valuev en 1863, à l'époque d'Alexandre II, refusant toute existence à la langue ukrainienne dans l'Empire russe.
Le simple fait que la «naissance» de la langue littéraire ruthène de Slovaquie ait été mise en doute par des Ruthènes ukrainophiles montrent que l'existence même d'une langue pose des problèmes étonnants dès que les enjeux politiques viennent s'y mêler. En effet, d'une part le problème est discuté au plan ontologique, jamais au plan épistémologique (la seule alternative est «elle existe / elle n'existe pas»). D'autre part, deux types de raisonnement s'entremêlent. En fait, la codification est tout à la fois conséquence et condition préalable de l'être :
1) elle existe, donc nous l'avons codifiée
2) elle existe, puisque nous l'avons codifiée
Dans ce passage subreptice d'un connecteur argumentatif à un autre, le résultat est une fabrication d'ontologie, où les verbes «être» et «exister» reviennent de manière obsessionnelle.
On remarquera un fait rarement souligné, à savoir que les différentes traditions linguistiques n’observent pas les mêmes objets : en Europe centrale et orientale, on distingue les «langues littéraires» des autres, pas en France ou en Grande-Bretagne, où cette distinction n’a aucun sens. Les linguistes s’y intéresserait plutôt à la variation.[6] C’est que les thèmes d’intérêt des linguistes ne sont
[214]
pas sans lien avec les préoccupations politiques du moment.[7] Si les langues étaient des choses, pourquoi ferait-on tant d’efforts pour les constituer en «langues littéraires» ? Ainsi, combien y a-t-il de langues slaves ? A question simple, réponse complexe. On serait tenté de dire : autant qu’il y a de projets politiques d’entités étatiques. Et là, la question du nom est incontournable.De plus, cette question n’est pas séparable d’une vision évolutionniste stadialiste, téléologique, du couple langue / nation. Dans le discours sur la langue en Europe centrale et orientale, les langues peuvent se trouver à différentes étapes d’un même parcours orienté vers le couronnement final, par exemple, à «l’étape prénationale» de la langue littéraire (donacional'nyj period literaturnogo jazyka). Mais la «langue littéraire» est bien l'aboutissement final naturel et nécessaire de l'évolution de toute langue, tôt ou tard.
Enfin, la question de la «langue littéraire» est rendue encore plus complexe par une terminologie flottante. La «langue littéraire» est souvent synonyme de «langue nationale», laquelle à son tour peut être dite «langue native» (rodnoj jazyk en russe, ridna mova en ukrainien)[8]. Notons qu'il arrive que dans les recensements les enquêtés répondent par exemple «ukrainien« à la question de la langue native alors que leur langue maternelle est le russe, ce qui montre que les deux notions ne sont pas synonymes.
Dans ce glissement incessant de l'être au devoir-être, plusieurs mots-clés reviennent, qui sont autant d’«obstacles épistémologiques» ou simplement de chausses-trappes : on a l’impression que l’identité est moins à découvrir qu’à inventer. Ces mots sont :
1) «considérer» (X comme Y)
2) «reconnaître» (les X comme des Y)
3) «déclarer», «proclamer» (que les Y sont/ne sont pas des Y)
Ces verbes ruinent les prétentions d’un discours naturaliste : nul n’aurait l’idée de «considérer» que les citrons sont des mandarines, alors que le discours sur l’être à propos des langues et des peuples tourne autour de la question de savoir si l’on doit «considérer» que les Ruthènes sont ou ne sont pas des Ukrainiens.
[215]
Il ne faut pas se méprendre : ce discours sur l’être n’est pas l’apanage d’un coin perdu de l’Europe de l’Est. Il s’agit d’une idéologie bien précise, qui a pris forme à l’époque romantique en Europe occidentale comme refus de l’universalisme de la philosophie des Lumières. Ce à quoi nous avons affaire ici est de l’ordre d’un décalage temporel. Les PECO sont la dernière zone d’instabilité frontalière en Europe : des frontières récentes, issues du «sort des armes» de la seconde Guerre mondiale et des traités voulus par les vainqueurs.On finira cette partie sur les noms et les choses par une citation du philosophe italien Giorgio Agamben, qui nous rappelle que les langues et les peuples ne sont ni des objets d’observation ni des objets d’évidence.
«Nous n'avons pas, en effet, la moindre idée de ce qu'est un peuple ni de ce qu'est une langue (il est bien connu que les linguistes peuvent construire une grammaire, c'est‑à‑dire cet ensemble unitaire doté de propriétés descriptives, qui se nomme langue, en se fondant sur le factum loquendi, c'est‑à‑dire le simple fait que les hommes se parlent et se comprennent entre eux, qui reste inaccessible à la science), et, cependant, toute notre culture politique repose sur la mise en relation de ces deux notions. L'idéologie romantique, qui a opéré sciemment cette combinaison et, de cette manière, a largement influencé tant la linguistique moderne que la théorie politique toujours dominante, a tenté d'éclairer quelque chose d'obscur (le concept de peuple) par quelque chose d'encore plus obscur (le concept de langue). À travers la correspondance biunivoque qui s'établit ainsi, deux entités culturelles contingentes aux contours indéfinis se transforment en organismes presque naturels, dotés de caractères et de lois propres et nécessaires. Car, si la théorie politique doit supposer sans pouvoir l'expliquer le factum pluralitatis (ainsi désignons‑nous, par un terme étymologiquement lié à celui de populus, le simple fait que les hommes forment une communauté) et si la linguistique doit présupposer sans l'interroger le factum loquendi, la seule mise en correspondance de ces deux faits fonde le discours politique moderne.» (Agamben, 1995, p. 76, cité dans Tabouret-Keller, 2001, p. 350)
3. Etre ou ne pas être : qui doit décider?
Pour entrer dans le concret, et pour que des lecteurs «occidentaux» non familiarisés avec ce monde des PECO, pourtant si proche d'eux dans l'espace, puissent juger de la réalité de la «question de la langue» à l'heure actuelle, nous allons entreprendre une étude de cas. On examinera les arguments échangés au cours de la première rencontre entre des représentants officiels du gouvernement ukrainien et des «représentants des minorités de Transcarpathie», les 4-7 sept 1998 lors d’un colloque «Inter-Ethnic Relations in Transcarpathian Ukraine», à Mukačevo (cf. cartes). Cette ren-
[216]
contre fut organisée sous le patronage de l’ECMI (European Centre for Minority Issues, une ONG dont le siège est au Danemark).J'entends exposer l'argumentation explicite et implicite d'un discours apparemment contradictoire, où les protagonistes de l'affrontement partagent pourtant les mêmes présupposés ontologiques : un discours de vérité qui est discours sur l'être. Tout le monde est enfermé dans les mêmes certitudes romantico-platoniciennes sur ce qui existe et ce qui n'existe pas. Il faut lire alors ce qui ne se dit pas, ce qui ne doit surtout pas se dire entre adversaires qui partagent une même vision du monde.
En fait, en s'affrontant au niveau explicite, tous sont d'accord sur l'implicite. Seuls les «experts internationaux», tels que le représentant du Conseil de l'Europe ne comprennent pas, et sont totalement dépassés : on sent leur embarras dans leurs interventions, lorsqu'ils proposent des «instruments législatifs», et qu'ils se heurtent à un conflit dont ils ne saisissent pas les présupposés idéologiques. Pour eux, seul un cadre législatif cohérent permet de résoudre le problème des minorités, mais ils n'entrent pas en matière pour répondre à la question qui taraude les participants locaux : «les Ruthènes sont-ils ou non une minorité nationale?».
On voir ainsi des positions incompatibles s'affronter sur un fond de non-dit. Etonnant dialogue de sourds, entre des gens qui partagent les mêmes présupposés, à savoir que les noms renvoient à des choses. Pendant ces quatre jours de septembre 1998, les onomatoclastes étaient tous en même temps des onomatolâtres.
Le fait remarquable de cette rencontre est qu'au cours de la conférence, personne n’a émis l’idée que les Hongrois, Roumains, Russes, Juifs, Tchèques et Arméniens puissent ne pas être des minorités. Seuls les Ruthènes faisaient problème, sans que quiconque soulève le problème du rapport du nom à son (éventuel) référent.
Le représentant de l’ECMI, prenant fait et cause pour la minorité ruthène, présentait dans son rapport la situation en ces termes :
«Apparemment, ce n’est que dans la république d’Ukraine que les Ruthènes sont encore confrontés à un manque totale des droits les plus élémentaires en tant que groupe national, étant privés du droit de se désigner comme une nationalité distincte» (Trier, 1999, p. 3, cité dans Trier, 1998, p. 3).
S’échangent ainsi des arguments linguistiques et ethnolinguistiques, sur fond de tensions politiques (il y eut une rencontre entre des officiels du gouvernement central ukrainien et Ivan Turjanic’a, chef du «Gouvernement provisoire de Russie Subcarpathique», et un représentant du Conseil mondial ruthène).
[217]
L’enjeu des discussions a été de savoir si les Ruthènes sont une minorité nationale en Ukraine, majoritaire au sud des Carpathes, ou bien des Ukrainiens de l’Ouest? Sans que personne ne le dise, on allait parler du rapport des noms et des choses. Et c’est précisément là, à lire le compte-rendu du colloque, qu’apparaît un des aspects les plus étonnants de la situation : les adversaires partagent totalement les mêmes présupposés, le même implicite. La dispute n’a plus rien à voir avec celle qui opposait E. Renan et D. Strauss après la guerre franco-prussienne de 1870 : ici il n’y a pas deux logiques qui s’affrontent, deux définitions de la nation, une «objective» et une «subjective». Tous pensent qu’une nation, une minorité nationale, sont de l’ordre de l’évidence objective. Or, si l’implicte est partagé, l’explicte est ici fait de déclarations incompatibles.Le rapport du délégué de l’ECMI, à qui beaucoup d’informations sont empruntées ici, rappelle un certain nombre de faits d’ordre juridique.
Juste avant l’indépendance en 1991, la Déclaration de souveraineté étatique de l’Ukraine, adoptée par le Soviet suprême d’Ukraine en juillet 1990, garantissait à tous les groupes ethniques résidant sur le territoire de la république le droit à un «développement culturel et national».
Puis furent adoptées la Loi sur les langues en octobre 1989 et la Loi sur la citoyenneté en octobre 1991, toutes deux très libérales envers les citoyens ukrainiens qui ne sont pas de «nationalité» (c’est-à-dire d’ethnie) ukrainienne[9].
En novembre 1991, le Parlement adopte une Déclaration sur les droits des nationalités en Ukraine, garantissant aux minorités la protection de leurs droits après l’indépendance (devenue effective le 1er décembre 1991).
En juin 1992 le Parlement ukrainien adoptait la Loi sur les minorités nationales, garantissant à toutes les minorités nationales le droit d’apprendre et d’utiliser leur «langue native» (ridna mova, cf. plus loin), de recevoir un enseignement dans leur «langue native» dans les écoles de l’Etat, de mettre en place des associations culturelles, d’utiliser leurs symboles nationaux, de pratiquer leur religion, de créer des institutions culturelles et éducatives, et de subvenir à leurs besoins en littérature, art et moyens d’information.
La Constitution de juin 1996 stipule que la seule langue officielle de l’Etat est l’ukrainien, mais l’article 10 garantit le dévelop
[218]
pement libre, l’usage et la protection du russe et des autres langues des minorités nationales en Ukraine. L’article 11, soulignant le rôle de l’Etat dans la consolidation et le développement de la nation ukrainienne, garantit également le développement de «l’originalité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de tous les peuples et minorités nationales indigènes de l’Ukraine».L’Ukraine a même accepté une convention internationale contraignante en signant en septembre 1995 la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales.
Il ne m’appartient pas de chercher à évaluer dans quelle mesure l’Etat ukrainien a effectivement appliqué cette Convention dans la pratique, mais on va étudier pourquoi la situation ruthène est différente de celle des autres «minorités nationales», en comparant l’argumentation des parties en présence.
3.1. la preuve par l'évidence
Notons d’abord qu’il n’y a pas d’unanimité entre les experts locaux : l’un annonce comme une vérité élémentaire qu’il y a trois «nations titulaires» en «Subcarpathie» : les Ruthènes, les Ukrainiens et les Hongrois. Mais un autre expert local rétorque qu’il est dangereux de faire de telles déclarations sur qui a le droit de s’appeler «nation titulaire» : si les Russes, par exemple, sont arrivés plus tard que les autres dans la région, cela ne signifie pas qu’ils aient moins de droits que les autres.
On voit que la terminologie employée est ici parfaitememt soviétique : la notion de «nation titulaire» est un concept élaboré à l’époque stalinienne en URSS, instaurant une vision administrative d’une relation hiérarchique entre les «nations». Ainsi, à l’époque soviétique, les Tatars, bien que plus nombreux que les Kyrghizes, ne constituaient pas la «nation titulaire» d’une République fédérée, alors que ces derniers, «nation titulaire» de leur République, avaient droit, par exemple, à un enseignement dans leur langue à tous les niveaux, jusqu’à l’Université.
La plus large concession que puissent accorder les autorités centrales au niveau onomastique est l’appellation «Ruthènes-Ukrainiens», au grand dam des militants de la cause ruthène. Un représentant ruthène à la conférence affirme ainsi que les Ruthènes, et non les Ukrainiens, constituent la «nation titulaire», puisqu’ils sont la «population indigène» slave orientale de la région, et, malgré l’immigration russe et ukrainienne à l’époque soviétique, sont en même temps la population majoritaire. Pour lui, les
[219]
Ruthènes de la région sub-carpathique (et non trans-carpathique) ne sont pas une minorité, mais une majorité. Il revendique que les Ruthènes ne soient pas appelés «Ruthènes-Ukrainiens», mais bien plutôt «Ruthènes-non-Ukrainiens».Comme dans toute polémique bien montée, les mots de l’adversaire sont systématiquement défaits et refaits en sens inverse.
Cette discussion, impossible à l’époque soviétique, a repris force depuis 1989. Il y a eu plusieurs tentatives d’ouverture de dialogue, par exemple un colloque à l’Université d’Uzˇgorod, mais beaucoup d’intellectuels ruthènes ont refusé d’y participer, ce qu’un expert local interprète comme un refus de trouver une issue au conflit.
Un représentant ruthène, à partir de son expérience du fait d’appartenir à une minorité non reconnue, considère que la législation ukrainienne sur les minorités n’a qu’un caractère purement déclaratif. Pour lui, les autorités ukrainiennes continuent la politique soviétique du double standard. Il déclare que la politique ukrainienne envers les minorités et surtout les Ruthènes est anti-démocratique et humiliante.
Un autre représentant ruthène considère que depuis l'annexion de la région par l'URSS en 1946, il y a eu un ethnocide de la nation ruthène, consistant en la négation de l'identité nationale ruthène, l'interdiction de la religion traditionnelle ruthène : le culte gréco-catholique (uniate). Les écoles ruthènes ont été transformées en écoles ukrainiennes, les organisations civiles et culturelles ruthènes ont été prohibées. Pour lui, cette politique totalitaire d'ethnocide se continue après l'indépendance de l'Ukraine. Il s'agit d'une violation de la Convention-cadre par l'Ukraine, mais aussi de sa propre constitution : les Ruthènes n'ont pas la possibilité d'enseigner leur langue maternelle à leurs enfants, aucune radio ou télévision n'existe en langue ruthène, aucune aide matérielle n'est allouée par les autorités pour développer leur culture.
3.2. la parole des savants
Pour les représentants du gouvernement central, la question de la définition de ce qu'est une minorité est du ressort d'une analyse scientifique. L'un d'entre eux propose un raisonnement par l'absurde : que dirait-on si les habitants d'Odessa affirmaient être des «Odessites ethniques»? Cela suffirait-il à faire d’eux une minorité nationale?
[220]
Pour lui, la position de la République d'Ukraine est claire : l'article 3 de la Loi sur les minorités définit les minorités comme des citoyens ukrainiens qui ne sont pas des Ukrainiens ethniques et montrent un fort sentiment de conscience nationale. Quant à la question de savoir si les Ruthènes constituent une nation, elle est du ressort de l'Académie des sciences de Kiev et sera «tranchée de façon scientifique».Un représentant de la minorité ruthène réplique alors que c'est «un fait avéré» que les Ruthènes sont une nation de plein à part entière, et non un sous-groupe des Ukrainiens. Le représentant du gouvernement demande en retour des preuves scientifiques pour cette affirmation, et ajoute que de telles allégations demandent encore à être véfifiées.
Un expert international dit que le problème de savoir qui est une minorité et qui ne l'est pas ne doit pas être du ressort des scientifiques. Le statut d'un groupe ethnique appartient à la «volonté des nations», il n'est donc pas raisonnable d'attendre une décision de la part de l'Etat ou une étude faite dans une académie des sciences.
Le représentant du gouvernement répond qu'il considère que la question de savoir qui est une nation et qui ne l'est pas ressort de l'évidence, et qu'il envisage les Ruthènes comme un sous-groupe de la nation ukrainienne, sous-groupe qui, en théorie, pourrait un jour évoluer en une nation séparée, ce qui n'a encore jamais été le cas au cours de l'histoire.
3.3. les dangers de l'auto-désignation
Un représentant de l'administration régionale dit qu'en Transcarpathie chacun est absolument libre de s'identifier comme il le désire. Il ajoute que ce principe sera pris en compte dans le nouveau questionnaire qui sera utilisé lors du prochain recensement, le premier qui aura lieu depuis le recensement soviétique de 1989, et qui doit se dérouler en janvier 1999 (il fut ensuite repoussé à 2001). Ce questionnaire ne contient aucune catégorie pré-déterminée d'origine ethnique, et les enquêtés peuvent répondre par n'importe quelle dénomination ethnique, selon leur désir.
Mais un représentant ruthène exprime alors un certain nombre de réserves. D'abord il craint que les Ruthènes, même s'ils répondent massivement «ruthènes» à la question de l'identité ethnique, soient toujours considérés comme un sous-groupe des Ukrainiens : le nom n'est pas une garantie. De plus, bien que tous les Ruthènes forment une seule et même nation, ils se désignent eux-mêmes par
[221]
une grande variété d'ethnonymes, tels que Ruthènes, Carpatho-Ruthènes, Rusnaks, Lemkos, Bojkos, Hutsuls, etc. Malgré ces différentes appellations, ils parlent tous la même langue maternelle (langue native), le ruthène, qui est «entièrement différent» de l'ukrainien. Mais il exprime la crainte que les analystes du recensement interprètent les désignations telles que Rusnaks ou Hutsuls comme ukrainiens au lieu de ruthènes. Le risque est alors celui d'une assimilation forcée.3.4 La raison d'Etat
La représentante de la minorité russe déclare qu’avant la désintégration de l’URSS en 1991 il n’y avait aucun besoin de défendre les minorités nationales en Transcarpathie, car les relations inter-ethniques étaient caractérisées par une grande tolérance. Mais elle omet de dire que les Russes et leur langue avaient une position relativement privilégiée : ils étaient du bon côté de l’idéologie d’Etat.
Un représentant ruthène considère, quant à lui, comme intolérable de permettre aux gouvernements d'Etats-nations de définir la notion de «minorité». Cette façon de faire est une violation des droits des citoyens à l'auto-identification.
Un représentant du gouvernement ukrainien répond qu’à l’heure actuelle l’Ukraine a résolu tous les problèmes de législation en matière de minorités, et que ceux qui subsistent ne sont que d’ordre pratique (implémentation), et que même les Etats les plus démocratiques connaissent des problèmes pratiques. L’important est que les parties entrent dans un dialogue constructif.
Un «représentant de la société civile ukrainienne» affirme que la question ruthène n’est pas un conflit inter-ethnique, mais intra-ethnique. Il rappelle la division de la population locale au 19e siècle entre orientations pro-hongroise, pro-russe et pro-ukrainienne.
Mais sa position est ambiguë, entre une attitude objectiviste et subjectiviste[10]:
a) il appelle au respect envers les Ukrainiens qui ont décidé de se désigner comme Ruthènes, tout comme envers ceux qui préfèrent s’appeler Ukrainiens. Il y a bien apparence de distance, on renvoie les adversaires dos-à-dos, on pourrait même arriver jusqu’à penser l’arbitraire de la désignation; mais en fait toute la question est faussée par le sujet grammatical : «les Ukrainiens qui…»;
[222]
b) il rappelle que tous les Ruthènes sont, fondamentalement, des Ukrainiens : «pour les spécialistes des questions ethno-nationales, il ne fait absolument aucun doute que les Ruthènes constituent un sous-groupe ethnique de la nation ukrainienne».Ici, le nom appartient intrinsèquement à la chose
Il ajoute que «ce serait une faute grave si le gouvernement acceptait le ‘ruthénisme politique’, qui est une tentative de séparatisme, en accordant des écoles ruthènes, une autonomie ruthène, etc. En revanche, il concède la possibilité d'organiser des activités culturelles comme concerts, festivals folkloriques, etc., en tant qu'expression de la culture d'un sous-groupe régional des Ukrainiens.
La position du représentant du gouvernement est ainsi que tout va bien. Il a pour cela des arguments juridiques, visiblement adressés aux experts internationaux : la République d'Ukraine a signé et ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe sans aucune restriction, à la différence de certains pays d'Europe[11].
Peut-on être juge et partie?
Le représentant du Conseil de l'Europe rappelle que, selon les normes légales internationales, les Etats devraient s'abstenir de donner eux-mêmes une définition de ce qu'est une minorité nationale. Il admet que la Convention-cadre, qui est formulée en termes vagues, ne donne aucune définition de ce qu'est une minorité nationale. Mais ce fait ne doit pas être interprété par les Etats comme les habilitant à définir leurs propres minorités nationales. Du point de vue du Conseil de l'Europe, l'absence de définition univoque n'implique pas que les Etats soient habilités à ignorer les revendications de groupes qui se considèrent comme des minorités nationales.
Dans cette discussion, il y a beaucoup de Strauss, mais bien peu de Renan.
Si l'on veut bien pardonner tous ces hellénismes, on peut dire qu'ici, dans ce rapport de forces, l'onomatothète, ou donneur de noms, ne peut être que le nomothète, ou faiseur de lois.
Autrement dit, que c’est l’Etat qui fait la nation, et non la nation qui fait l’Etat.
Ou bien enfin que, dans la question du nom, de l’identité collective comme dans tant d’autres cas, la raison du plus fort est toujours la meilleure…
---
Bibliographie
— AGAMBEN G., 1995 : Moyens sans fin, Paris, Rivages.
— AGAMBEN G., 1997 : Homo Sacer I – le pouvoir souverain et la vie nue, traduction Marilène Raiola, Paris : Seuil.
— BAGGIONI Daniel, 1988 : «La linguistique comparée des langues indo-européennes et le fantasme des origines. Un enjeu national dans une période marquée par l'essor des Etats-nations et des nationalités.», Cahiers CRLH-CIRAOI, n° 4, p. 91-109.
— BARABOLJA Marko, 1929 : «Oj stelysja ty, barvinku, na joho mohyli» (Trahedija ne v dijach, ale dijet'sja v 1999 roci)», Tutešnjac'ka gubernija: satyry (Bratislava - Prešov, 1970).
— COMTET Roger (éd.) : Mosaïques germano-slaves et minorités d’Europe centrale et orientale, Slavica Occitania, n° 20, Toulouse, 2005.
— FILIN Fedot,1975 : «O svojstvax i granicax literaturnogo jazyka», Voprosy jazykoznanija, n° 6. [Sur les propriétés et les limites de la langue littéraire]
— MAGOCSI Paul Robert, 1987 : The Language Question Among the Subcarpathian Rusyns, Fairview, New Jersey : Carpatho-Rusyn Research Center.
— MAGOCSI Paul Robert, 1995 : (Letter to the editor) «A New Slavic Language is Born», East European Politics and Societies, vol. 9, n° 3, p. 534-537.
— SERIOT Patrick, 1997 : «Ethnos et Demos : la construction discursive de l'identité collective», Langages et Société (Paris : MSH), n° 79, p. 39-52.
— SERIOT Patrick, 2005 : «Diglossie, bilinguisme ou mélange de langues : le cas du suržyk en Ukraine», La linguistique, Paris : P.U.F., vol. 41, fasc. 2, p. 37-52.
— TABOURET‑KELLER Andrée : «La pureté de la langue», Traverses, 2 : Langues en contact et incidences subjectives, avril 2001, p. 343-357.
— TRIER Tom, 1998 : «Inter-Ethnic relations in Transcarpathian Ukraine», European Centre for Minority Issues (ECMI) Report #4, www.ecmi.de/download/report_4.pdf
— TRIER Tom, 1999 : «Introduction : Rusyns, Minority Rights and the Integration of Europe», in Trier Tom (ed.) : Focus on the Rusyns. International Colloquium on the Rusyns of East Central Europe, Copenhague : The Danish Cultural Institute.
— UNBEGAUN Boris,1953 : L’origine du nom des Ruthènes, Winnipeg : Académie ukrainienne libre des sciences.
[1] Sur l’origine du nom des Ruthènes, cf. Unbegaun, 1953. On a choisi d’utiliser ici le nom de «Ruthènes», mais peut-être faudrait-il dire «Roussines», ou «Roussiens», pour ne pas être accusé d’opter pour un point de vue autrichien. Le terme le plus courant en anglais est «Rusyns».
[2] Le piège du nom se referme inexorablement : comment, nous, appeler ces gens, puisque tout nom est déjà un choix politique ? Même la notion de «slave oriental» n’a rien de bien établi : à partir de quand un dialecte cesse-t-il d’être slave oriental pour devenir slave occidental ? où passe la limite? un dialecte slovaque oriental qui a perdu l’opposition de longueur est-il «encore du slovaque«, ou «déjà de l’ukrainien? un dialecte ukrainien occidental qui a un accent fixe sur l’avant-dernière syllabe est-il «encore de l’ukrainien» ou «déjà du polonais»? Quelle est la juridiction habilitée à trancher? Malheureusement, dans ces discussions, on est toujours juge et partie. En fait, le problème est classique : le nom est discontinu alors que la réalité dialectale est un continuum. Seule l’appartenance religieuse est un critère sûr : dans l’Empire autro-hongrois comme dans l’Empire russe, c’est l’Eglise qui tenait les registres de l’état-civil, on ne pouvait être enregistré que dans une paroisse, il n’y avait pratiquement aucune possibilité de changer de religion. Les confessions étaient séparées par une discontinuité stricte.
[3] A force de se méfier des noms qu’on utilise, l’écriture devient vite illisible. Pourtant c’est une question de salubrité publique de déjouer les pièges de la nomination.
[4] Sur le modèle des célèbres Pravidla českého pravopisu (‘Règles de l’orthographe tchèque’), qui ont bercé des millions de Tchèques depuis leur création, en 1846.
[5] Cf. Magocsi. 1995.
[6] «Langue littéraire» dans le monde francophone signifie à l’heure actuelle «langue des écrivains». Certes, on peut trouver «langue littéraire» chez Dauzat, même dans le Cours de Saussure, mais au sens assez flou de ce qui s'appelle maintenant «langue standard». L'assimilation de la «langue littéraire» à la «langue standard» a été refusée avec véhémence par de nombreux linguistes à l'époque soviétique, cf. Filin, 1975.
[7] Sur le lien entre thèmes de la linguistique et situation politique, cf. Baggioni, 1988.
[8] C’est sur le modèle de «locuteur natif» que je propose de traduire par «langue native», plutôt que «langue natale», en prenant également appui sur l’anglais «native language». Sur les rapports idéologiques entre la naissance et la nation, cf. Agamben, 1997. Curieusement, en polonais on dit «ojczyzny je˛zyk» : ‘langue paternelle».
[9] Sur la différence entre citoyenneté et nationalité en Europe centrale et orientale, cf. Sériot, 2005.
[10] Sur l’opposition entre ces deux attitudes à propos de la nation, cf. Sériot, 1997.
[11] Comme la France, P.S.
- Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECLECO) / Université de Lausanne // Научно-исследовательский центр по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы