-
- Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECLECO) / Université de Lausanne // Научно-исследовательский центр по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы
-- Charles de Brosses : Traité de la formation méchanique des langues et des principes physiques de l’étymologie, Paris, 1765
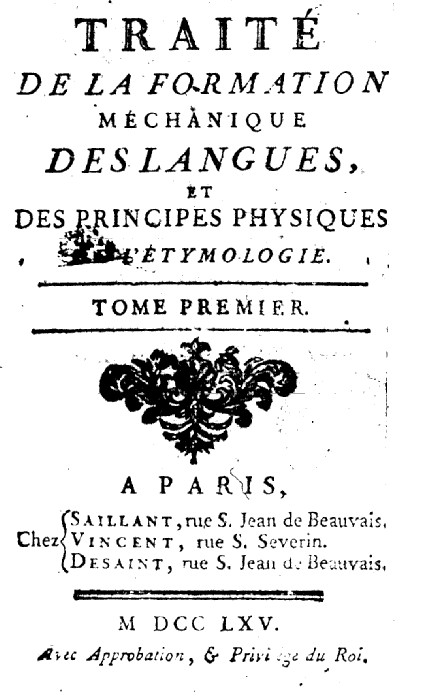
[iii]
Discours préliminaireLe traité sur les éléments du langage qu’on donne ici au public est dès longtemps connu d’un assez grand nombre de gens de lettres. L’ouvrage manuscrit est resté pendant plusieurs années entre les mains de quelques uns d’entre eux, passant des uns aux autres ; et, sans parler de l’usage qu’on en a fait dans un vaste et célèbre recueil destiné à rassembler les découvertes et les connaissances humaines, on en trouve quelques fois les pensées et les expressions dans quelques li-
[iv]
vres récents, dont le sujet engageait à parler, soit de la matière ou de la forme du langage, soit de la philosophie du discours.
Les vues de l’auteur ont porté sur ces trois points en composant l’ouvrage qu’on va lire ; mais il s’est surtout occupé des deux premiers, comme d’un préliminaire indispensable, avant que d’arriver au troisième. Le vrai ou le faux des idées dépend, en grande partie, de la vérité ou de la fausseté des expressions, c’est-à-dire de l’exacte correspondance des premières notions contenues dans chacun des termes qu’on emploie avec les idles nouvelles qu’on veut transmettre, ou avec les opinions qu’on veut établir. Si l’on
[v]
venait à décomposer les premières idées contenues dans les expressions mises en usage pour établir un sentiment, on serait souvent surpris de trouver si peu de rapport entre ces premières idées et celles qu’on reçoit comme en étant la suite. On serait du moins étonné de la singularité du passage des uns aux autres et de la marche bizarre de l’esprit humain. L’étymologie tient, de plus près qu’on ne croit, à la logique : c’est à les rapprocher tout-à-fait que ce traité est destiné.
Dans cette vue, on y remonte jusqu’aux premières causes, jusqu’aux principes élémentaires de l’expression des idées, par la formation des mots, afin d’en déduire
[vi]
avec plus de connaissance et de justesse les rapports et le degré de force que ceux-ci doivent avoir, lorsqu’ils sont rassemblés en troupes nombreuses. Car on ne parvient à connaître la force du discours résultant de l’assemblage des termes, qu’autant qu’on a commencé par bien connaître la force des termes mêmes, leur valeur réelle et primitive, leur acception conventionnelle et dérivée, qui ne s’est établie, bien ou mal à propos, que sur le véritable et premier sens physique du mot, que sur un rapport réel enttre les termes, les choses et les idées.
L’auteur a donc pensé que c’était à l’examen de ces rapports qu’il devait d’abord s’arrêter, s’il
[vii]
voiulait conduire le lecteur au but proposé. Pour découvrir la source et le cours de quantité d’opinions répandues parmi les hommes, il a pris la voie d’observer les fondements vrais ou faux dans la fabrique même des mots qu’ils ont inventés pour exprimer leurs idées, dans l’assemblage et les nuances de couleurs qu’ils ont employées pour peindre aux autres hommes les objets de la nature tels qu’ils les voyaient eux-mêmes. Car, en quelque langage que ce soit, surtout dans ceux des peuples policés, il y a bien peu d’expressions si simples qu’on ne trouve, en les décomposant, qu’elles sont elles-mêmes un assemblage d’un certain nombre de traits, d’objets et d’i-
[viii]
dées, réuni dans un seul petit tableau, par lequel on veut faire une impression prompte et claire sur l’esprit à qui on le présente.
Pour réussir à cette espèce d’analyse, il a fallu remonter jusqu’aux racines qui ont produit les mots usités dans le langage humain, en découvrir le premier germe, et suivre les développements de branches en branches, observer comment et pourquoi ils ont été produits tels qu’ils frappent notre oreille, en un mot, arriver au dernier degré de l’analyse, aux principes les plus simples et vraiment primitifs, puisqu’il est très vrai qu’ici, comme dans tous les effets naturels, les grands développements qui nous affectent
[ix]
d’une manière si sensible ne sont que la suite nécessaire et l’expression des premiers germes imperceptibles.
Reconnaissant alors
que ce germes de la parole si variée et des langages si multipliés chez tant de peuples ne sont autres que les inflexions simples et primitives de la voix humaine,
que la forme de chaque inflexion ou articulation vocale, dont le bruit arrive à l’oreille par l’ondulation de l’air, dépend de la forme et de la construction de l’organe qui le produit,
que la construction de chaque organe est déterminlée par la nature, en telle sorte que l’effet suivant nécessairement d’une cause
[x]
donnée et mise en action, un organe ne peut produire d’autre effet, ni moduler l’air d’une autre manière que de celle que sa structure naturelle lui a rendue possible,
que chacun des organes de la voix humaine a sa structure propre, de laquelle résulte la forme du son qu’il rend, déterminée par la forme même de sa construction,
que les organes qui composent l’instrument total et le méchanisme complet de la voix humaine sont en petit nombre,
que, par conséquent, le nombre des articulations vocales doit y correspondre, et ne peut être plus grand puisque c’est là tout
[xi]
l’effet que la machine peut produire.
Ces premières observations, fondées sur les principes physiques des choses, telles que la nature les a faites, amènent les conséquences suivantes.
Que les germes de la parole, ou les inflexions de la voix humaine, d’où sont éclos tous les mots des langages, sont des effets physiques et nécessaires, résultant absolument, tels qu’ils sont, de la construction de l’organe vocal et du méchanisme de l’instrument indépendamment du pouvoir et du choix de l’intelligence qui le met en jeu.
Que les germes étant en très petit nombre, l’intelligence ne
[xii]
peut faire autre chose que de les répéter, de les assembler, de les combiner de toutes les manières possibles pour fabriquer les mots tant primitifs que dérivés et tout l’appareil du langage.
Que, dans ce petit nombre de germes ou d’articulations, le choix de celle qu’on va faire servir à la fabrique d’un mot, c’est-à-dire au nom d’un objet réel, est physiquement déterminé par la nature et par la qualité de l’objet même, de manière à dépeindre, autant qu’il est possible, l’objet tel qu’il est, sans quoi le mot n’en donnerait aucune idée ; tellement que l’homme qui sera dans le cas d’imposer le premier nom à une chose rude, emploiera une inflexion
[xiii]
rude et non pas une inflexion douce ; de même qu’entre les sept couleurs primitives un peintre qui veut peindre l’herbe est obligé d’employer le vert et non pas le violet. Sans chercher plus loin, on en peut juger par le mot rude et par le mot doux : l’un n’est-il pas rude et l’autre doux ? Supposons un Caraïbe qui voudrait nommer à un Algonquin un coup de canon, objet nouveau pour ces deux hommes qui ne s’entendent pas ; il ne l’appellerait pas Nizalie, mais Poutoue.
Que le système de la première fabrique du langage humain et de l’imposition des noms aux choses n’est donc pas arbitraire et conventionnel, comme on a coutume de se le figurer, mais un vrai sys-
[xiv]
tème de nécessité déterminé par deux causes. L’un est la constuction des organes vocaux qui ne peuvent rendre que certains sons analogues à leur structure ; l’autre est la nature et la propriété des choses réelles qu’on veut nommer. Elle oblige d’employer à leur nom des sons qui les dépeignent, en établissant entre la chose et le mot un rapport par lequel le mot puisse exciter une idée de la chose.
Que la première fabrique du langage humain n’a donc pu consister, comme l’expérience et les observations le démontrent, qu’en une peinture plus ou moins complète des choses nommées ; telle qu’il était possible aux organes vo-
[xv]
caux de l’effectuer par un bruit imitatif des objets réels.
Que cette peinture imitative s’est étendue de degrés en degrés, de nuances en nuances, par tous les moyens possibles, bons ou mauvais, depuis les noms des choses susceptibles d’être imitées par le son vocal, jusqu’aux noms des choses qui le font le moions ; et que toute la propagation du langage s’est faite, de manière ou d’autre, sur ce premier plan d’imitation dicté par la nature ; ainsi que l’expérience et les observations le prouvent encore.
Que les choses étant ainsi, il existe une langue primitive, organique, physique et nécessaire, commune à tout le genre humain,
[xvi]
qu’aucun peuple au monde ne connaît ni ne pratique dans sa première simplicité ; que tous les hommes parlent néanmoins, et qui fait le premier fond du langage de tous les pays : fond que l’appareil immense des accessoires dont il s’est chargé laisse à peine apercevoir.
Que ces accessoires sortis les uns des autres de branches en branches , d’ordre en sous-ordres, sont tous eux-mêmes sortis des premiers germes organiques et radicaux, comme de leur tronc ; qu’ils ne sont qu’une ample extension de la première fabrique du langage primitif tout composé de racines : extension établie par un système de dérivation suivi pas à
[xvii]
pas, d’analogies en analogies, par une infinité de routes directes, obliques, transversales, dont la quantité innombrable, les variétés prodigieuses et les étranges divergences constituent la grande diversité apparente qu’on trouve entre tous les langages ; que néanmoins toutes les routes, malgré la diversité de leur tendance apparente, ramènenent toujours enfin, en revenant sur ses pas, au point commun dont elles se sont si fort écartées.
Que puisque le système fondamental du langage humain et de la première fabrique des mots n’est nullement arbitraire, mais d’une nécessité déterminée par la nature même, il n’est pas possible que le
[xviii]
système accessoire de dérivation ne participe plus ou mains à la nature du premier dont il est sorti en second ordre ; et qu’il ne soit comme lui plutôt nécessaire que conventionnel, du moins dans une partie de ses branches.
Que le langage humain et la forme des noms imposés aux choses n’est donc pas, autant qu’on se le figure, l’opération de la volonté arbitraire de l’homme ; que dans la première fabrique du langage humain et des noms radicaux, cette forme est l’effet nécessaire des sensations venues des objets extérieurs, sans que la volonté y ait eu presque aucune part ; qu’elle en a eu même beaucoup moins qu’on ne l’imagine aux dériva-
[xix]
tions, toujours tirées des premiers noms radicaux et imitatifs des objets réels, même lorsque la dérivation vient à s’exercer, non sur des objets physiquement existants dans la nature, mais sur des idées, sur des objets intellectuels qui n’ont d’existence que dans l’esprit humain, en un mot, sur des êtres abstraits qui n’appatiennent qu’à l’entendement ou aux autres sens intérieurs.
Qu’après être remonté aux premiers principes du langage, tirés de l’organisation humaine, et de la propriété des choses nommées, il est important et convenable de redescendre au développement de ces principes, d’observer les effets de la dérivation, après avoir connu
[xx]
ses causes et ses éléments ; d’examiner par quelles voies elle a passé du physique au moral, et du matériel à l’intellectuel ; de démêler, par l’analyse des opérations successives, l’empire ou l’influence de la nature dans le mécanisme de la parole et de la formation des mots, d’avec ce que l’homme y a mis d’arbitraire par son propre choix, par l’usage, par la convention reçue ; de montrer par quelles déterminations, par quelles méthoses, et jusqu’à quel point l’arbitraire a travaillé sur le premier fond physiquement et nécessairement donné par la nature.
C’est sur ces principes étudiés et reconnus que l’on considère ici
[xxi]
la foule immense des langues répandues sur toute la terre, dans ce qu’elle a seulement de général, de primordial et de commun, comme si c’était un objet unique, sans égard à ce que la grande diversité du climat, des mœurs et des usages, de la façon de penser et de procéder a mis de particulier dans chacune. Plusieurs personnes éclairées ont trouvé quelque chose de neuf et d’intéressant dans cette méthode d’appliquer ainsi l’an alyse et la synthèse à la formation du langage, sans autre guide que la nature suivie pied à pied dans ses opérations.
Une partie des principes et des opérations ci-devant exposées étaient déjà connues ; mais elles
[xxii]
avaient été faites sans suite, et d’une manière isolée.On a vu qu’elles acquéraient un grand degré de force par l’ensemble et par l’enchaînement. Leur liaison jette une nouvelle lumière philosophique sur tout le système du langage humain, en découvrant de quelle manière la physique et la métaphysique se sont d’elles-mêmes, et comme par instinct, adaptées à la grammaire. On a trouvé que cette méthode traçait une large voie pour entrer à découvert dans un vaste canton de la métapysique jusqu’alors peu connu, et où on n’avait encore pénétré que par des sentiers.
Leibniz disait qu’il serait à souhaiter que la philosophie con-
[xxiii]
sacrât une partie de ses recherches à la discussion des méthodes et des inventions grammaticales. On verra, non sans quelque surprise, que les Indiens avaient autrefois suivi une idée à peu près semblable. Ce qu’on nous raconte de la langue des Brachmanes indique qu’ils avaient procéd d’une manière presque aussi parfaite et aussi vraie qu’il était possible ; et il est vrai que la haute antiquité avait fait de plus grands progrès dans les sciences que nous ne sommes portés à le croire, aujourd’hui que ses monuments sont perdus. Ce que Leibniz demandait. on tâche de le faire ici, non pour les syntaxes dont il ne sera question qu’en passant, mais pour les
[xxiv]
mots qui sont la matière première des syntaxes. On ne s’occupe pas, ainsi que l’ont fait quelques grammairiens, à fabriquer par art une langue factice, qui par l’usage universel qu’on en pourrait faire, tant verbalement que par écrit, tiendrait dans le commerce et dans les connaissances de toutes les […] le même lieu que que l’algèbre tient dans les sciences numérales ; projet qu’on ne peut espérer de faire jamais adopter aux hommes dans la pratique. On se borne à montrer ici que ce fond de langage universel existe en effet. Au lieu de perdre le temps à essayer, sans fruit, ce que l’att pourrait faire, on y met à découvert ce qu’a fait la nature. Il
[xxv]
y a au moins plus de réalité dans le résultat de ce travail qu’il n’y en aurait dans l’autre.
On y décrit d’abord l’organe de la voix humaine, le nombre, la forme et le jeu de chacune des parties qui composent cet instrument admirable, l’ordre dans lequel la nature les développe et les met en jeu, les effets nécessaires de chaque partie dans le mouvement matériel et dans les modulations qu’il imprime à l’air ; les différences et les propriérés de chaque articulation ; le nombre fixe et vrai, tant des voyelles que des accents et des consonnes ; comment, et par quel mouvement doux, rude ou moyen, chacune des consonnes part de chaque or-
[xxvi]
gane en forme simple, ou se fléchit sur un organe voisin, pour prendre une forme composée. On observe les variétés que produit dans la voyelle le passage du son par l’un ou par l’autre des deux tuyaux de l’instrument vocal, la bouche et le nez. On indique quelles peuvent être les causes de la différence si sensible qui se fait entendre entre la voix parlante et la voix chantante. On donne une formule d’écriture organique très simple, dont chaque élément correspond juste à chaque organe et à son mouvement propre, formule qui n’a d’autre usage que de servir de glossomètre pour mesurer le degré de comparaison entre les langages, et vérifier la justesse des
[xxvii]
étymologies et dérivations. Tout ceci est la technique de la chose, fatiguant et ennuyeux pour le lecteur, mais indispensable, puisqu’il écrit les opérations de la nature, lesquelles fondent les principes d’où sortent les conséquences et les développements.
On cherche ensuite quelle est la langue primitive, et, après avoir indiqué où lôn doit la chercher, on montre comment elle procède, en quel ordre,en quelle suite d’ordres, par quels rapports naturellementz établis entre certains organes,certains sentiments, certaines sensations, certaines existences physiques, et modalités d’existence. On prouve que tout est primitivement fondé
[xxviii]
sur l’imitation des objets extérieurs, tant par les sons vocaux que par les figures écrites ; que l’impossibilité de faire parvenir à l’ouïe, par un bruit imitatif, les objets de la vue, a forcé d’avoir recours à un autre genre d’imitation susceptible de tomber sous cet autre sens, et donné naissance à l’écriture. On suit les différents ordres, gradations et développements de ce nouvel art, depuis l’écriture primitive en figures, jusqu’aux caractères alphabétiques. On montre que les ordres et les suites sont du même genre dans l’écriture comme dans la parole, en ce que la nature a de même servi de guide, en donnant les principes et les développements,
[xix]
par de semblables procédés d’imitation, d’approximation et de comparaison ; jusqu’à ce qu’enfin l’homme ait totalement changé le système de l’écriture, en s’attachant à peindre, non les objets extérieurs comme ci-devant, mais les mouvements de chacun des organes vocaux, par l’invention d’un alphabet. On remarque comment s’est faite cette admirable réunion des deux sens de la vue et de l’ouïe, qui assujettit les objets de l’un et de l’autre sous un même point, en même temps que les objets et les sensations restent réellement très séparées. On remarque encore combien le genre des procédés et des sensations qui ont principalement servi à la for-
[xxx]
mation de chaque langage contribuent à le caractériser, et servent à ranger les langues sous deux classes principales, dont l’une s’adresse aux yeux, et l’autre aux oreilles. On traite de la formule d’écriture de chaque nation ancienne et moderne, brute, sauvage et policée, des variations et des progrès successifs de l’art, des chiffres ou formules d’écriture numérale de chaque peuple.
Les objets généraux ayant ainsi été présentés, on descend à l’examen un peu plus particulier de la formation d’une langue quelconque (à la supposer primordiale) et de son progrès. On examine son enfance, son adolescence, sa maturité, les causes qui con-
[xxxi]
courent à son accroissement, à sa syntaxe, à sa richesse, puis à son altération, à son déclin, et enfin à sa perte ; celles qui la constituent en apparence langue mère ; celles qui la subdivisent réellement en dialectes. On marque ce qui constitue l’identité d’une langue parlée, en fixant le point de l’époque où elle existe, et celui de l’époque où il semble qu’elle n’existe plus, quoiqu’on n’ait pas pas discontinuà de la parler, mais avec tant d’altération qu’elle n’en pataît plus ressembler à ce qu’elle était dan sl’époque précédente. On suit les effets de la dérivation et de la descendance des langues l’une de l’autre. On démêle la suite des altérations successives que subis-
[xxxii]
sent les termes dans le son, dans le sens, dans la figure ; le passage des unes aux autres ; leur marche naturelle ou bizarre ; les causes des fréquentes anomalies. On traite de toutes les formes d’accroissements qu’un mot primitif est sujet à recevoir ; des nouvelles forces que ces formes additionelles donnent au mot, par les idées accessoires qui s’y joignent, à chaque accroissement qu’il reçoit ;de la valeur significatif de chaque augmentatif et de ses causes. On donne la formule générale et particulière des syntaxes, avec l’exemple d’un son radical suivi dans tous les développements qu’il reçoit, en un seul sens principal, et en une seule syntaxe.
[xxxiii]
On traite ensuite des noms imposés aux choses qui n’ont pas une existence réelle et physique dans la nature, tels que sont les êtres intellectuels, abstraits, moraux, les relations, les qualités générales, etc. On prouve que ces noms n’ont pas d’autre origine ni d’autre principe de formation que les noms des objets extérieurs et physiques (matière très curieuse). De là on passe aux noms propres de personnes et de lieux, en montrant qu’il ont tous une valeur significative, tirée des objets sensibles, en indiquant les causes de leur imposition, et les diverses manières de les imposer, pratiquées par les différents peuples.
[xxxiv]
Revenant ensuite aux principes généraux et aux règles de l’art étymologique, on traite des racines, de leur premier germe, de leurs branches sorties du primitif ou premier tronc, et souvent prises elles-mêmes, dans l’usage, pour autant de primitifs, des branches subdivisées presque à l’infini ;de leur écart prodigieux ; des causes de leurs étonnantes divergences ; de la manière de les suivre et de les rapeler à leurs principes. On observe que les racines, qui fond le fond des langues, y sont elles-mêmes presque partout inusitées, et que la plupart d’entre elles ne sont que des outisl généraux servant à former les mots d’usage ; semblables en cela aux concep-
[xxxv]
tions arbitraires et générales de l’esprit humain, qui, en nommant des êtres qui n’existebnt réellement pas eux-mêmes, sont néanmoins employées à l’expression de presque tous ceux qui existent en effet. On enseigne la manière d’appliquer l’art critique à l’étymologie. On tâche de guider ceux qui s’adonneront aux recherches de cette espèce dans les routes qu’ils doivent tenir pour arriver du centre aux extrémités, et revenir des extrémités au centre ; pour trouver le fil et la source d’une dérivation quelconque ; pour discerner les caractères de vérité et de fausseté, de justesse et d’erreur entre plusieurs étymologies données d’un
[xxxvi]
même mot. On termine ce Traité en traçant le plan et la méthode très détaillée de former un vocabulaire général de toutes les langues, ou une nomenclature universelle par racines. On fait voir qu’un dictionnaire de cette espèce et de cette forme, loin d’être un ouvrage immense et impraticable, comme on le croirait, est non seulement possible sans une très grande peine, mais qu’il serait fort utile à l’avancement et à la facilité de la science, et qu’il est même devenu nécessaire, vu la multiplication des langages et des connaissances humaines qui iront en croissant, à tel point que, sans cette aide, l’étude seule des
[xxxvii]
langues absorberait à l’avenir un temps auquel la vie de l’homme ne pourrait plus suffire.Les observations et les principes généraux sont soutenus, surtout dans les deux dernières parties de l’ouvrage, d’exemples propres à les prouver et à les rendre plus sensibles. Les exemples, souvent curieux, quelques fois qgréables, adoucissent un peu la sécheresse des raisonnements abstraits dont ce livre est rempli. Toute matière grammaticale est ingrate par elle-même. Toute considération métaphysique est fatiguante. Qu’en doit-il arriver quand elles sont réunies ? C’est pourtant leur réunion qui doit piquer ici la curiosité du lecteur,
[xxxviii]
et qui peut rendre ce livre utile, au cas que l’auteur ait pu parvenir à le rendre tel. Il y a si peu de personnes qui se plaisent aux sujets de cette espèce et traités de cette manière qu’il n’ose se promettre d’être lu par beaucoup de gens. Tout l’amusement qu’il pourront espérer de cette lecture est celui qu’on trouve à voir développer, dans toutes ses conséquences, un système nouveau, fondé sur des principes très simples et très vrais ; à faire soi-même le fil des laisons qui joignent l’une à l’autre des choses entre lesquelles on n’entrevoyait aucun rapport ; à se convaincre, à mesure qu’on avancera dans cette lecture, que des propositions, que leur singularité avait
[xxxix]
d’abord fait prendre pour très hasardées, sont néanmoins justes et véritables ; à tenir devant ses yeux un tableau naturel et raccourci du langage et de l’esprit humain, présenté sous un nouveau point de vue.
Il serait à désirer qu’on eût pu couvrir l’aridité de la matière par les agréments du style. Il n’y a point de sujet qui n’en soit susceptible ; et s’il manque de ceux qui sont propres au genre, c’est toujours la faute de l’écrivain. Mais il est rare d’en trouver qui soient capables de mettre dans un livre de grammaire autant de grâces et d’élégance que nous en voyons dans Quintillien, et que Jules César avait mis, sans doute,
[xl]
dans son Traité de l’analogie. Dans cet ouvrage-ci, on a seulement tâché d’être clair, et de rendre avec le plus de netteté possible des idées abstraites, souvent difficiles à exprimer, et peut-être n’y a-t-on pas toujours réussi.
Si l’ouvrage a peu de lecteurs, en revanche peut-être trouvera-t-il beaucoup de critiques. On répond d’avance, à ceux qui blâmeront les traductions les traductions un peu inexactes d’un mot comparé d’une langue à une autre, par exemple d’un indicatif rendu par un infinitif, qu’on n’a pas besoin de plus de précision lorsqu’il ne sagit que de considérer le sens absolu et la forme radicale des mots. A ceux qui jugeront que les exemples
[xli]
cités ne sont pas toujours aussi bien choisis qu’ils pouvaient l’être pour rendre la proposition plus sensible, que cela est quelque fois vrai, parce que les exemples qui avaient d’abord offert à l’esprit une vérité claire n’y reviennent pas toujours, au moment qu’on écrit, telks quôn les désirerait, et que, las de ne pouvoir se les rappeler, on se contente trop facilement de ceux qui se présentent en leur place. A ceux qui rejetteront les étymologies données, parce qu’ils en préfèrent d’autres, que tel est leur avis, différent de celui de l’auteur qui est en droit, comme eux, d’avoir le sien sur cette matière, laissant au public à décider de la préférence, et que,
[xlii]
dans le cas où l’ateur se serait trompé sur certaines dérivations, l’application fausse ou mal choisie d’un exemple particulier ne détruirait pas la vérité d’une proposition ou d’un principe général, auquel on l’aurait mal appliqué. A tous enfin, qu’on n’est nullement dans l’intention de répondre aux critiques qui porteront sur les détails épisodiques au sujet, mais seulement à celles qui, en attaquant les fondements de la théorie qu’on établit ici, renverseront l’édifice par le pied. Or c’est ce qu’on ne fera pas, à moins qu’on ne rompe la chaîne qui joint toutes les parties, ce qui ne serait l’ouvrage ni de quelques phrases ni de quelques pages, mais deman-
[xliii]
derait un traité tout aussi étendu, tout aussi suivi, que l’est celui-ci.
Il n’y a que le temps, le progrès des connaissances grammaticales, les observations multipliées sur un grand nombre de langages fort disparates, qui puissent assurer ou détruire cette théorie d’une manière parfaitement complète. On présente ici un système général. Il se trouve fort bien d’accord avec la nature et avec les expériences faites sur les langages familiers et connus, d’où sont tirés la plupart des exemples qu’on cite. La nature étant partout la même, on a quelque droit d’en conclure que les mêmes expériences, répétées sur tout autre langage, donneront les mêmes
[xliv]
résultats. Mais c’est le fait qui reste à vérifier. Les gens qui seront versés dans les langues barbares et tout à fait étrangères verront un jour si elles se rapportent, aussi bien que celles que nous connaissons, à une rthéorie qui pose pour principe que la première fabrique des mots consiste partout à former des images imitatives des objets nommés, et que la suite et le développement d’un langage quelconque n’est qu’une suite et un développement de ce même mécanisme, employé même dans les cas où il semble le moins propre et le moins applicable.
Mais observons qu’il faut s’être rendu bien profond dans la connaissance d’une langue barbare
[xlv]
avant que de l’éprouver sur cette théorie ; qu’il faut en connaître parfaitement les racines, les sources, la composition mélangée, les procédés, les acceptions, les dérivations idéales et matérielles, les analogies et les anomalies, et de connaître aussi surtout quel est le jeu des organes familiers à ce peuple-là ; qu’il ne faut pas se décider sur le peu de réussite des premiers essais, mais réfléchir qu’il n’y a point de langue si pauvre et si barbare qui ne soit déjà mélangée, par dérivation, d’une foule d’autres langages, tous infiniment éloignés de leur ancienne formation et de leur première origine ; que, puisque dans nos langues pratiques nous avons tant de peine
[xlvi]
à découvrir les racines, presque toutes inusitées dans le discours et étouffées sous la foule des rameaux qui les couvrent, à discerner la première opération de la nature au milieu du mélange confus des accessoires qui la cachent, il nous est bien difficile de ramene les choses à ce premier point de simplicité, sans une connaissance complète du langage examiné.
Souvenons-nous encore qu’avec le même dessein il est tout ordinaire de parvenir au même but par des moyens différents lorsque diverses routes y mènent toutes également ; qu’il suffit ici que les procédés soient inspirés par la nature, et du même genre, malgré les variétés qui se montrent dans la
[xlvii]
manière d’exécuter. Peindre un objet par l’une ou par l’autre de ses qualités apparentes, c’est toujours en vouloir tracer l’image. L’un tirera le nom roc de la dureté, l’autre, de la difficulté d’y grimper. Comparer la vitesse à un oiseau ou à une flèche ; nommer l’esprit, comme en langue égyptienne, papillon, ou comme en chaldéenne souffle aérien, c’est toujours comparer. Toutes les nations ont pour procédé naturel et commun, lorsqu’elles veulent marquer le degré superlatif d’une chose, de redoubler d’effort dans la prononciation, et de charger davantage la composition du nom. A cet effet, les Américians répètent deux fois de suite le mot simple. Les Grecs et les Latins augmen-
[xlviii]
tent le mot, en le terminant par un coup d’organe fortement appuyé ; mais, avec le même dessein d’exprimer mécaniquement le degré superlatif, les recs le peignent par –τατος, les Latins par –errimus ou –issimus. Tous parviennent au même but pr différentes espèces de moyens du même genre.
On en viendra un jour à comparer toutes les langues les unes aux autres, à mesure qu’elles seront bien connues, à les disposer toutes ensemble, et à la fois, sous les yeux dans une forme parallèle. Si jamais on exécute l’archéologue universel, ou tableau de nomenclature générale, par racines organiques, pour les langues qui nous sont connues, tel que l’auteur le propose, ce sdera un magasin tout pré-
[xlix]
paré pour y joindre celles dont on acquerrera la connaissance ; et il est plus que probable que tous les mots de chacune vindront facilement d’eux-mêmes se ranger chacun sous leur racine organique, dans leur case propre et préparée, jusqu’à ce qu’enfin on soit parvenu au complet sur cette matière. Mais n’omettons pas de remarquer à ce propos que les langages veulent y venir dans leur ordre successif de descendance et d’affinité. Une langue pourra bien d’abord ne pas soutenir l’essai, et ne prendre que difficilement place dans l’archéologue, parce que le rédacteur n’aura pu y placer d’autres idiomes intermédiaires, qui lui sont encore inconnus. Ceux-ci lui donneront,
[l]
après la découverte, le fil continu de la dérivation, le passage naturel d’une forme à l’autre : ils rempliront, par des nuances insensibles, l’intervalle vuide qui séparait auparavant deux langues déjà connues. Ainsi tout viendra peu à peu se ranger en bon ordre dans le glossaire général.
Sans la crainte de retenir trop longtemps le lecteur sur un sujet si peu fait, il faut l’avouer, pour être du goût de tout le monde, l’autur avait dessein d’ajouter deux aures volumes à ces deux-ci, pour donner l’application (indiquée chap. II) de sa théorie grammaticale à plusieurs autres sciences, surtout à la géographie en ce qui concerne les noms de lieux,
[li]
à la mythologie, à l’histoire des anciennes nations, à celle de l’émigration et de la transplantation des peuples. Il a cherché dans cette partie de l’ouvrage la suite des différents peuples qui ont successivement habité une région, les traces de leur langage conservées dans les noms qu’ils ont imposés aux lieux, lesquels ont presque tous une force significative convenable à leur position ; les langages antérieurs, dont chaque idiome subsistant est composé en différentes doses. Il examine et explique les noms anciens, tant des rois quew des divinités de chaque pays, en faisant voir combien l’intelligence de la signification propre de ces noms explique naturelle-
[lii]
ment les faits historiques et les usages ; montre l’origine des fables qui les défigurent, et fait évanouir le faux merveilleux ; sert, en un mot, à lever ce voile obscur que la nuit des temps, l’erreur et le mensonge ont jeté sur des événements très ordinaires. L’histoire des colonies et de leur parcours sur la surface de la terre tient de fort près à l’histoire des langages. Le meilleur moyen de découvrir l’origine d’une nation est de suivre, en remontant, les traces de sa langue comparée à celle des peuples avec qui la tradition des faits nous apprend que ce peuple a eu quelque rapport. Il y a même des cas où. par la conformité du langage, on reconnaît, à n’en pou-
[liii]
voir douter, que deux peuples ont une origine commune, quoique l’histoire n’en apprenne rien, quoique la langue mère de ces deux-ci soit inconnue ou perdue.Ces derniers volumes, si les premiers sont goûtés des gens de lettres, sont destinés à expliquer l’histoire par signification de smots et des noms imosés aux choses ; à vérifier ce qu’on a dit (n° 199) que l’anatomie du mot donnait fort bien, pour l’ordinaire, soit la définition de la chose nommée, soit la description du fait allégué ; à montrer que la littérature confirme, en grande partie, ce que le raisonnement seul avait suggéré. - Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECLECO) / Université de Lausanne // Научно-исследовательский центр по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы