- -- Patrick SERIOT : «La linguistique spontanée des traceurs de frontières», in P. Sériot (éd.) : Langue et nation en Europe centrale et orientale, du 18ème siècle à nos jours, Cahiers de l'ILSL (Univ. de Lausanne), n° 8, 1996, p. 277-304.
[277]
Entre au-delà et en-deçà : la déchirure
(Daniel BEAUVOIS, 1988, p. 8)
Si les langues et les nations étaient des objets dénombrables, si l'on pouvait les recenser comme font les botanistes pour les fleurs des champs, établir des critères précis pour en délimiter les classes et les sous-classes, en définir les limites réciproques, bref, si ces étranges objets étaient semblables à des espèces naturelles, il n'y aurait pas lieu de se poser des questions classiques sur le rapport entre le nom de ces objets et leur existence (ontologie), et sur les modes de connaissance de ces objets (épistémologie).
Or, si les langues et les nations ne sont pas des objets naturels, si leurs limites sont incertaines, leur centre n'est pas plus assuré que leur périphérie, leur homogénéité est aussi mouvante que leur identité est instable. Langues et nations, pas plus que les cultures, ne ressortissent de l'évidence.
Il s'est trouvé, pourtant, bien des gens pour qui langues et nations étaient des objets non seulement naturels, mais encore strictement discontinus et homogènes, au point que savoir reconnaître les limites d'une langue équivalait à tracer les frontières de la nation correspondante.
C'est du discours sur l'équivalence entre langue et nation comme objets naturels et distincts, et de la pratique qui en découle qu'il va être ici question. Le matériau en sera essentiellement les situations de confins en Europe centrale et orientale, propices à une réflexion sur les marges, les
[278]
limites, les frontières, les seuils, tout ce qui fait que du continu peut être nommé, et donc pensé comme du discontinu.
1. Langue et nation, objets naturels équivalents?
La langue est, sans contredit, une des caractéristiques les plus essentielles d'une nation, puisqu'elle permet les rapports entre ses divers membres; la langue est l'expression de la pensée; elle conditionne l'épanouissement d'une littérature nationale et c'est par elle enfin qu'une nation manifeste son idéal, c'est son meilleur aiguillon; la langue est-elle en décadence, commence-t-elle à céder la place à une autre, la vitalité nationale s'en ressent. (Ivanoff, 1919, p. 16)
1.1. Continu et discontinu, homogène et hétérogène
Dans cette réflexion sur la distinctivité, on prendra comme analogie le continuum du spectre solaire. Les «différentes» couleurs visibles sont des longueurs d'onde qui forment une suite continue, et c'est la nomination d'entités qui va, dans ce continuum, découper des objets homogènes qui auront pour nom le bleu, le vert, etc. Or, le découpage en sept couleurs principales date d'Isaac Newton, qui a donné sept noms en référence aux sept planètes connues à son époque, ou aux sept notes de la gamme. Le nombre même des couleurs principales du spectre est arbitraire du point de vue physique (pourquoi sept couleurs et pas huit?) : on a donné un nom spécial (indigo) au bleu-violet, ce qui ne paraît pas plus nécessaire que d'en donner un au vert-bleu ou au vert-jaune. De plus, ce découpage dépend des langues : on sait que, par exemple, en gallois il n'y a qu'un mot pour ce qui correspond au vert et au bleu du français, en russe il y a en revanche deux mots différents pour ce que nous appelons le bleu, etc. Ce découpage peut même varier, à l'intérieur d'une même langue, d'un corps de métier à l'autre (cf. en français les termes de cyan et magenta chez les imprimeurs et les photographes).
[279]
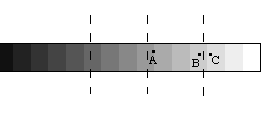
Si l'on prend 3 points A, B et C, objectivement, en termes de longueur d'onde, la distance entre B et C est inférieure à celle qui sépare A et B. Néanmoins, à partir du moment où dans ce continuum on a découpé avec des noms, alors A et B font partie du même, tandis que B et C relèvent du différent. Le même et le différent, dans ce cas, ressortissent d'un problème de nomination, et non pas d'une mesure dans le continu. Certes, cette analogie a ses limites, puisque les langues et les nations ont une histoire, alors que les couleurs n'en ont pas. Mais l'important ici est que la frontière entre les objets appelés couleurs est purement nominale. «Les» couleurs sont des grandeurs mesurables mais non dénombrables.
Lorsqu'il s'agit maintenant du continuum dialectal, on sait depuis Gilliéron et les néo-linguistes italiens qu'entre le continu et le discontinu il existe encore autre chose qui est, disons, le graduel, fait à la fois de continu et d'hétérogène. Ce graduel fait que d'un dialecte à l'autre, et même d'un phénomène dialectal à l'autre, il y a superposition, recouvrements et recoupements, un passage non pas purement progressif, mais fait d'interpénétrations et d'imbrications. Il y a en général bonne intercompréhension d'une aire dialectale à une aire voisine, tandis qu'aux deux extrémités de la chaîne il peut y avoir incompréhension totale (1).
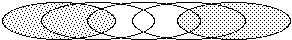
[280]
Le problème est de savoir comment, à partir d'un continu hétérogène ont pu être distingués des objets-langues discontinus et homogènes, dont les limites ont pu être pensées comme assimilables à celles d'une nation. Or la pensée du discontinu hétérogène prend comme point de départ ce dont elle entend démontrer l'existence : ces objets conjoints, sortes d'étoiles-doubles, que sont les nations-langues. Dans la pensée du discontinu hétérogène, les langues-nations sont justiciables d'une énumération, elles s'égrènent, s'ordonnent en une liste selon un principe permettant d'en épuiser la totalité.
1.2. La relation langue/nation : deux notions, deux situations
Il faut avant tout rappeler que la relation langue/nation a une histoire différente selon les différents pays européens.
Dans la France de l'Ancien Régime, la langue française n'était aucunement une langue «nationale», mais la langue nécessaire à l'administration et à l'élite intellectuelle. La Révolution, en ce domaine, a apporté un brusque changement de point de vue : le triomphe de la langue française était le triomphe de la Nation et de la Raison.
A la même époque, au contraire, en Allemagne, c'est la communauté de langue qui servait à définir la nation, et qui sera à la base de la revendication d'un État national unifié. La Nation française est un projet politique, né dans de violentes luttes politiques et sociales. La Nation allemande, au contraire, est apparue d'abord dans les travaux des intellectuels romantiques, comme une donnée éternelle, reposant sur une communauté de langue et de culture (c'est une Kulturnation, s'opposant à une Staatsnation). Pour les romantiques allemands, la langue était l'essence de la nation, alors que pour les révolutionnaires français, elle était un moyen pour parvenir à l'unité nationale. Aussi pouvons-nous, en première approximation, opposer deux définitions du mot «nation» au 19e siècle. En France, dans l'idéologie jacobine, qui trouve son origine dans la philosophie du Contrat social, le peuple souverain proclame l'existence de la nation, une et indivisible. C'est l'État, c'est-à-dire une entité politique, qui donne naissance à la Nation. Dans la conception romantique allemande, au contraire,
[281]
la Nation précède l'État. Le «Volk» (que l'on pourrait traduire par «groupe ethnique»), est une unité par essence, reposant sur une communauté de langue et de culture. Dans la conception romantique, au commencement était la langue et la culture, alors que dans la conception jacobine issue des Lumières, la langue n'est qu'un moyen d'unification politique. On opposera ainsi en allemand deux notions : Gesellschaft (ou société, produit politique, artificiel), et Gemeinschaft (ou communauté, objet naturel). En fait, il semble que l'idée allemande de Kultur soit liée à des pratiques culturelles traditionnelles, voire paysannes, alors que l'idée française de civilisation est plutôt liée à la ville et à des valeurs «bourgeoises», qui doivent être étendues au territoire national tout entier, au détriment de la culture paysanne (les dialectes locaux, modes de vie traditionnels, etc.). L'idée romantique allemande de nation est un système organique dans lequel la langue est porteuse d'une «culture nationale» et est liée au «peuple» de façon irréversible (sur ce point, cf. Baggioni, 1986). La conséquence en est que, dans la conception romantique allemande, le peuple a déjà une langue, alors que dans la conception jacobine française la langue «commune» doit être imposée à la population entière de la nation, même, et surtout, à cette partie du peuple qui ne la connaît pas. On trouvera la première expression de la théorie romantique de la nation dans le cinquième Discours à la nation allemande, de Fichte (1807) :
Ce qui parle la même langue, c'est déjà, avant toute apparition de l'art humain, un tout que par avance la pure nature a lié de lignes multiples et invisibles. [ ] Un pareil tout ne peut admettre en son sein aucun peuple d'une autre origine ou d'une autre langue, ni vouloir se mêler avec lui.
Ces deux approches de la nation ont souvent été résumées en termes de «théorie objective» et «théorie subjective», ou bien de «conception ethnique» et «conception élective» (cf. Dumont, 1985). Il me semble plus approprié de parler de théorie naturaliste et de théorie contractualiste, qui peuvent être présentées en termes d'«ethnos» et «demos», c'est-à-dire dans l'opposition entre le sens romantique du mot «peuple» et son sens social. La définition jacobine de la nation se manifeste alors dans un jus soli (droit du sol), la définition romantique allemande dans un jus sanguinis (droit du sang).
Le fossé d'incompréhension entre définitions de la nation en Europe de l'Ouest (moins l'Allemagne, mais avec la Suisse) et en Europe Centrale et Orientale (avec l'Allemagne) repose précisément sur cette opposition entre «demos» et «ethnos», sur une controverse implicite entre le fondement politique et le fondement ethnique de la «nation».
[282]
Dans le mouvement révolutionnaire du début du 20e siècle, on peut observer une opposition similaire, mais cette fois entre les marxistes d'Europe occidentale, pour qui l'appartenance de classe est le critère principal qui détermine un individu, et les marxistes d'Europe centrale et orientale (autrichiens et russes), pour qui l'appartenance nationale devait aussi être prise en compte. Il n'est pas indifférent qu'une polémique se soit à son tour engagée entre ces derniers : les «Austro-marxistes» définissaient la nation sans égard au territoire, alors que pour les Bolcheviks, la nation était «une communauté humaine stable, historiquement constituée, née sur la base d'une communauté de langue, de territoire, de vie économique et de formation psychique, qui se traduit dans une communauté de culture» (cf. Staline, 1913, trad. fr, 1978, p. 15 ).
A cette divergence de définition correspond une différence de situation.
En France, et en Angleterre, la langue officielle, la langue qu'on peut appeler standard, s'est faite à partir des dialectes et au-dessus des dialectes en une lente et longue évolution historique. Dans ces deux cas, c'est un État qui est à l'origine de la formation d'une nation. En Europe centrale et orientale, en revanche, l'émergence des «langues nationales» (à ne pas confondre avec des «langues standards»), est plus brusque, elle répond à une entreprise beaucoup plus volontariste, dans la mesure où l'on sait que, par exemple, «le» serbo-croate est le produit d'un accord signé entre deux personnes (Vuk Karadzic et Lj. Gaj) à Vienne en 1850 (2), langue normée à partir d'un compromis entre un certain nombre de dialectes. Il en va de même, par exemple, pour le rôle de Kollár, ou Stúr pour la normalisation (ou création?) du slovaque dit «littéraire» (3) . Dans ces pays, c'est une certaine idée de la langue (ainsi que de la culture, de la religion, du territoire, bref, de la communauté) qui est à l'origine de la nation. On peut ainsi donner les noms de ceux qui, à partir de ce continuum, ont fabriqué une unité discontinue, homogène (ou tendant à l'homogénéité) et normée. Une chose, en tout cas, est frappante, c'est l'importance démesurée de la question de la langue en Europe centrale et orientale en ce qui concerne la «question nationale».
[283]
Or, ce n'est pas le moindre des malentendus que les revendications «nationales» au sens ethnique prennent le plus souvent pour base les «principes de la Révolution française».
Entre le Congrès de Vienne de 1815 et le Traité de Versailles de 1919 le principe des souverains, ou principe de légitimité, a laissé la place au principe des nationalités. Dans la plupart des manuels on trouve l'idée que ce passage s'est fait aux alentours de la révolution de 1848, «sous l'influence des idées de la Révolution française». Il me semble que «l'influence des idées de la Révolution française» repose sur un grand malentendu. Si le «Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes» est bien un principe de la Révolution française, la notion de «peuple» telle qu'elle apparaît dans l'Est de l'Europe lors des révolutions nationales de 1848 ne parlait pas du même peuple que la Révolution française.
Dans ce nouveau type de pensée, autour de 1848, on entend un leitmotiv : là où il y a langue il y a nation, là où il y a langue distincte il y a nation distincte. On perd la notion jacobine de citoyenneté (politique) pour adopter la notion romantique de nationalité (ethnique), en utilisant une même constante : le mot «peuple».
1.3. Le principe des nationalités : une linguistique spontanée
La confusion des deux niveaux : celui du continu hétérogène et celui du discontinu homogène, ainsi que de leur mode de construction, provoque des incompréhensions, des contradictions, des paradoxes, dont, à mon avis, le Traité de Versailles de 1919 est l'exemple le plus classique.
Le Traité de Versailles est un cas typique d'une pensée qui fait l'adéquation entre la distinction des langues et la distinction des nations, et qui a eu des conséquences tout à fait pratiques dans la politique européenne et dans la préparation de la seconde guerre mondiale.
Dans les débats qui ont précédé et suivi le Traité, une certaine idée de la langue est mise en avant, et c'est cette représentation de la langue que j'appellerai la linguistique spontanée, variante de ce que, en 1985 S. Auroux a appelé «linguistique fantastique». Il s'agit ici de la représentation de la langue qu'on trouve chez des gens qui ne sont pas des linguistes professionnels et qui parlent de la langue. La linguistique spontanée des traceurs de frontières est une pensée du discontinu et de l'homogène,
[284]
alors qu'une linguistique de terrain fait apparaître une situation complexe, hétérogène et continue.
Les décideurs du Traité de Versailles (le «Conseil des quatre») ont des visions divergentes de l'avenir de l'Europe, mais ils se rangent tous derrière les «Quatorze points» du Président Wilson, dont le Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes forme l'essentiel. Ici, «peuples» et «nations» fonctionnent comme synonymes. Wilson ne donne aucune définition de ce qu'est une nation (4), mais il semble admis que la langue en est le critère essentiel : là où il y a langue, il y a nation. Clémenceau, visiblement, se range à cet avis; pourtant ce critère, qui semble avoir le mérite de la simplicité, est vite inopérant. Une anecdote raconte que, voulant savoir si le Luxembourg est ou non une nation, Clémenceau demande au Roi des Belges quelle est la langue que l'on parle au Luxembourg. Or la réponse est embarrassante pour Clémenceau, car le Roi des Belges lui explique que la langue des actes administratifs est le français, mais que la langue effectivement employée par les gens dans la conversation est un dialecte germanique. Dès le début, le critère d'adéquation, ou d'accouplement, langue / nation est ainsi mis en défaut.
Il faut savoir aussi que le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'était pas partagé comme valeur générale par tous les participants du Traité, puisque le propre secrétaire d'État de Wilson, R. Lansing, écrit dans ses notes, le 20 décembre 1918 :
Quand le Président parle d'autodétermination, quelle unité a-t-il en tête? Entend-il par là une race? une aire territoriale? une communauté? Sans une unité de mesure définie, l'application de ce principe est dangereuse pour la paix et la stabilité. (Lansing, 1921, p. 93, cité par Sukiennicki, 1984, p. 28)
1.4. Représenter spatialement les objets continus hétérogènes.
La délimitation et la distinction des objets langues-nations est-elle un problème empirique?
[285]
Avant d'examiner la situation de l'Europe centrale et orientale dans la première moitié du 20e siècle, il convient de prendre comme premier exemple un document tout à fait intéressant pour notre propos, qui date de 1988. Il s'agit d'une carte tirée de l'Atlas des futures nations du monde, dessinés par François Fontan, qui était le chef du Parti Nationaliste Occitan, inspirateur aussi du courant qui s'appelle en France l'ethnicisme.
Une première remarque s'impose : sur cette carte, la Suisse n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de langue suisse. Il y a en revanche une entité territoriale linguistique, donc nationale, qui va de la Suisse romande à la péninsule du Cotentin, qui forment du même, alors que la même Suisse romande et, par exemple, la région d'Avignon, beaucoup moins éloignées géographiquement, appartiennent à des entités différentes. Le territoire où est parlé le français en tant que langue officielle (territoire proclamé illusoire) est ainsi découpé en unités supposées plus réelles, sans que d'ailleurs on s'interroge sur la mesure permettant de décréter que les dialectes de Suisse romande ont la moindre chance d'être reconnus comme étant identiques à ceux de Normandie. L'idée fondamentale de F. Fontan est que les frontières actuelles sont des frontières fausses, les seules frontières authentiques étant les frontières de langue. On est pourtant en plein paradoxe, parce qu'on ne sait jamais s'il s'agit du continuum dialectal ou des discontinuités de cette langue qu'on peut appeler en français la langue standard et qui en Europe centrale et orientale s'appelle en russe literaturnyj jazyk, en tchèque spisovny jazyk et en serbo-croate knjizevni jezyk (5) .
La place manque pour faire un commentaire complet de cette carte. On doit noter néanmoins que l'Allemagne non plus n'est pas un objet unique, puisqu'il y a, de la Mer du Nord à la Poméranie, un territoire dénommé la Néerlandie: F. Fontan ne s'intéresse ni à la langue néerlandaise normée, ni au Hochdeutsch, mais considère qu'il y a un ensemble homogène constitué par les dialectes néerlandais et le Plattdeutsch, tandis que le Hochdeutsch va ici de l'Alsace jusqu'en Suisse alémanique, dont les dialectes sont censés être suffisamment proches de ceux d'Allemagne pour autoriser une continuité nationale fondée sur le Hochdeutsch.
Les autres objets découpés dans cette carte sont tous censés représenter une vérité venant s'imposer à un faux découpage, mais ces objets
[286]
représentent à leur tour parfois une vision globalisante rapide. F. Fontan pense que la Tchécoslovaquie est une unité. Il y a donc une langue tchécoslovaque (ou, à l'inverse, il considère que le tchèque et le slovaque constituent une seule et même langue, ce qui lui permet de constituer un objet homogène «nation tchécoslovaque»). Quant à la «Serbocroatie», cet objet étrange se passe de commentaire (6). En ce qui concerne la Hongrie, on voit que la plaine de Pannonie est prolongée par une petite languette qui s'enfonce vers la Transylvanie. Fascination, là encore, pour le continuum territorial homogène: la Pannonie et la Transylvanie forment ici un même territoire, elles sont reliées, sans qu'on tienne compte du fait de la discontinuité, de la coupure sur le terrain. Dans ces figures graphiques du même et de l'autre, la Roumanie ressemble alors à une grande bouche ouverte, prête à avaler cet appendice hongrois. La Prusse orientale et les Sudètes sont germanophones, donc leur territoire doit être rattaché à la nation allemande; le Kosovo est en Albanie et la Macédoine en Bulgarie. Enfin des entités nouvelles apparaissent, telles que la Krivitchie (débordant le territoire de l'actuelle Biélorussie), ou la Permie.
Tout ce raisonnement consiste à prendre au pied de la lettre la citation de Fichte donnée plus haut, sur le fait que «toutes les fois où il y a une langue, il y a une nation différente». L'introduction à cet ouvrage donne d'ailleurs explicitement quelques principes :
Il n'y a pas de peuple sans langue, pas de langue sans culture, et tout peuple a droit à un territoire. (Ben Vautier, 1988, p. 4)
Il s'agit donc d'une définition naturelle, ou plus exactement naturaliste du rapport entre langue et nation :
Dans le monde vivant, humain et animal, la notion de territoire s'accompagne toujours des moyens de délimitation de ce territoire. Le territoire du lion est délimité par l'espace sur lequel son rugissement s'entend. L'homme, lui, délimite son territoire par la langue; ainsi, il y a territoire d'un groupe humain (italien, kurde, sarde) là où une langue est ou fut parlée jusqu'à une date récente. [ ] Les frontières d'un peuple sont ses frontières linguistiques et culturelles, c'est-à-dire là où la langue est ou a été parlée. (ib.)
[287]
F. Fontan (cf. ses «Propositions pour un programme international ethniste», document annexé) propose des déplacements et des échanges de populations là où un territoire a un peuplement mixte. Ce refus de l'hybridation, du flou, du recouvrement est une forme de fascination pour la pureté, l'homogénéité.
Certes, du point de vue linguistique, cette carte ne repose pas sur des critères sérieux, c'est pourquoi il ne faut pas lui accorder une importance démesurée. Il convenait toutefois d'en signaler l'existence, pour souligner que la définition «objective» de la nation n'est pas absente en terrain français à l'heure actuelle.
Un deuxième document, récemment envoyé par l'Ambassade de Croatie à Berne aux départements de slavistique des Universités suisses est la carte dénommée «Approaching a Europe of the Languages», publiée à Barcelone par le CIEMEN en 1987.
Là également le territoire français et le territoire allemand sont divisés en deux langues, mais déjà le Plattdeutsch et le néerlandais sont des objets différents. Le tchèque et le slovaque sont séparés; on parle tchèque dans les Sudètes et russe en Prusse orientale. Quant au territoire de l'ex-Yougoslavie, il est divisé en deux par une ligne parfaitement nette : la Croatie et la Serbie sont supposées se reconnaître au premier coup d'?il, par la différence entre les langues. Cette carte admet en revanche des territoires linguistiquement hybrides : on y parle grec dans le Sud de l'Albanie et albanais dans le Nord de la Grèce.
Enfin un troisième document mérite attention : il s'agit d'une carte de la National Geographic Society des États-Unis, datant de l'été 1994. L'idée, là aussi, est que la véritable Europe n'est pas celle que l'on pourrait penser, c'est l'Europe des régions. Il existe ainsi une «Old Burgundy», formant un continuum avec le Languedoc et la Provence. La Suisse n'existe pas non plus, la nation ruthène est différente de la nation ukrainienne. On voit sur cette carte des zones en grisé, correspondant aux «terres irrédentes». Cette notion d'irrédentisme est fondamentale, car elle suppose une continuité anhistorique entre un peuplement ancien est un peuplement actuel.
[288]
Ainsi, la Transylvanie est supposée être peuplée entièrement de magyarophones irrédentistes (7). Mais ce qui est grave pour un document établi dans l'été 1994 est que la Prusse orientale est supposée être peuplée entièrement de germanophones, de même que la Poméranie. La prestigieuse et savante National Geographic Society des États-Unis a-t-elle été abusée au point d'éditer une carte de «revanchards»? C'est en tout cas avec des cartes de ce type que raisonnaient les états-majors dans les années 1920-30.
Or ce type de pensée de l'homogène et du discontinu a une vieille histoire. On en trouvera un exemple particulièrement manifeste dans la carte que F. Ratzel annexe à son livre : Deutschland, 1898.
F. Ratzel, chef de file de l'école d'anthropogéographie, est un représentant typique de l'époque de Bismarck. L'idée, encore une fois, est que les frontières étatiques, fondées sur des traités, sont des mauvaises frontières, des frontières artificielles. Les seules véritables frontières sont les frontières naturelles, non pas au sens de la géographie physique, mais les frontières des peuples. L'idée générale est ainsi qu'un peuple a un territoire naturel, fondé sur l'extension maximale de sa langue.
Sur la carte de Ratzel le territoire «germanique» forme un seul tenant, de la Mer du Nord aux Alpes valaisannes. Il s'agit, de toute évidence, d'un territoire découpé selon des critères linguistiques, et non historiques ou politiques. En effet, le flamand, langue du groupe germanique, est considéré comme une variété de la même totalité que l'allemand. C'est pourquoi depuis Dunkerque (en flamand Dunkerke, transcrit ici Dünkirchen) jusqu'à Klagenfurt on trouve un territoire homogène, qui englobe Bruxelles (Brüssel) et Luxembourg. Ce territoire homogène s'effrite peu à peu à l'Est de Wróclaw (Breslau), chaque trace de la colonisation prussienne formant une petite île qui se perd dans la mer polonaise. Celle-ci est à son tour arrêtée par la barrière des «Russes», dont les «Ruthènes» ne sont qu'une variante (il n'y a chez Ratzel ni Biélorusses ni Ukrainiens en tant qu'entités autonomes).
Mais toute représentation graphique discontinue permet des regroupements ou, au contraire, des divisions, qui sont autant de créations d'objets homogènes, se surimposant au continuum. Par exemple la région de Lille est déclarée «wallonne». Les «Wallons» et les «Français» sont des
[289]
peuples romans, mais séparés, alors que les Flamands et les Allemands sont une seule et même entité : le «peuple germain»
Ce type de travail, qui débouche sur une représentation graphique, a des fondements empiriques (il suffit d'aller voir sur le terrain qui parle quelle langue pour savoir à qui appartient tel ou tel territoire), mais en même temps il crée les objets dont il entend prouver l'existence.
Le discours naturaliste dans le domaine des langues et des nations repose, à mon avis, sur une assimilation indue, sur une métaphore prise pour une réalité. Pour cartographier la limite nord de la culture de l'olivier, on va sur le terrain, on reporte sur la carte les points les plus septentrionaux où se trouvent les oliviers, on les relie par des lignes, et on obtient une carte représentant un état de choses. Il en va de même pour les terrains calcaires ou argileux : il suffit d'aller y voir, et de reproduire avec minutie ses observations sur la carte. La cartographie des langues et des nations a ceci de différent que l'acuité de l'observation est insuffisante pour représenter graphiquement ces objets : langues et nations ne relèvent pas des sciences naturelles.
A. Meillet lui-même, contemporain des discussions du Traité de Versailles, dans un livre révélateur de l'état d'esprit de l'époque, plein de parti-pris sur les langues ayant droit ou non à l'existence, affichait une opinion très prudente sur la possibilité de tracer des limites :
Là où chaque parler se développe d'une manière autonome, en subissant peu l'action des parlers voisins, le dialecte demeure vague, même si les innovations communes sont nombreuses; car le domaine où se produit une innovation ne concorde jamais au juste avec le domaine où s'en produit une autre. [ ] Bien des discussions qui se sont élevées sur les limites de telle ou telle langue sont vaines. On en aperçoit la vanité quand on sait que les «dialectes» n'ont pas de limites définies, et qu'il n'y a de limites exactes que de chaque fait linguistique en particulier. (Meillet, 1918, p. 165-167)
C'est également la position de L. Tesnière, qui écrit, à propos de l'éventuelle distinction du polonais et du kachoube :
Pour un linguiste, surtout pour un adepte des nouvelles méthodes de géographie linguistique, la question n'a pas beaucoup de sens. Il y a toujours, d'un dialecte à l'autre, des transitions graduelles et insensibles. A partir de quand dirons-nous que deux parlers cessent d'être la même langue et relèvent de deux langues différentes? La question ne comporte pas de réponse précise. (Tesnière, 1933, p. 69)
[290]
Toutes les discussions autour de l'existence et des limites des objets doubles que sont les langues-nations relèvent de l'ontologie la plus classique. Elles peuvent se ramener à quelques formules-types :
— les X sont-ils des Y ou non?
— la langue X est-elle «du Y» ou non?
Ici le problème est essentiellement celui du verbe être. Mais il se dédouble à son tour lorsqu'on introduit dans la discussion des verbes d'attitude propositionnelle :
— W considère que les X sont des Y
— Les X se considèrent comme des Y
— On peut considérer que leur langue c'est du X et non pas du Y.
On voit à quel point on s'est éloignés de la cartographie de la culture des oliviers, dont l'existence n'a que faire des modes de l'être : il est absurde de «considérer que» les oliviers sont des citronniers. Mais dans le cas des langues-nations cette ontologie ne peut pas se contenter d'évidences : il ne suffit pas d'aller sur place voir comment ça se passe, on n'a pas affaire à un objet naturel préexistant aux catégories discursives qu'on utilise pour les nommer (8).
2. Le travail de terrain : une solution illusoire
Comment fait-on pour savoir si un objet est une partie d'un tout, ou bien un tout à lui tout seul? Comment savoir qui parle quelle langue sur un territoire donné? Le critère qui semble aller de soi est l'enquête de terrain. Pourtant cette approche empirique créait autant de problèmes qu'elle prétendait en résoudre.
2.1. Les recensements
Les recensements indiquent toujours la langue et la nationalité, au sens ethnique et non au sens politique de citoyenneté dans l'Empire allemand
[291]
et en Autriche-Hongrie (on va voir plus loin que le problème est différent dans l'Empire ottoman).
Le problème est que les gens déclarent leur langue dans un choix entre des catégories discrètes. Ils doivent mettre une croix dans une colonne : on ne peut pas être à la fois polonais et allemand, hongrois et slovaque : il faut choisir. Dans l'Empire allemand et en Autriche-Hongrie la liste des catégories est fermée et exclusive.
Voici un exemple du domaine polonais.
Les Kachoubes (9) sont la population de la Poméranie orientale, région qui correspond au «corridor de Dantzig» de l'entre-deux-guerres. Historiquement, ces slavophones, descendants des anciens Slaves poméraniens, ont développé des liens étroits avec la Pologne, tout en gardant une indépendance relative. Le caractère individuel du pays s'est mieux préservé que dans d'autres duchés de Pologne. Le rôle important de la bourgeoisie a fait naître dans cette région une conscience de différence et d'autonomie. De 1772 à 1918 la Poméranie orientale fait partie du royaume de Prusse. Elle est habitée par des Kachoubes, des Polonais et des Allemands, ces derniers essentiellement dans les villes. Il semble que les habitants autochtones, les Kachoubes, étaient assez indifférents envers l'idée de nationalité. Ne s'intéressant ni à leur origine ni à leur histoire, il étaient simplement «les paysans de quelqu'un». C'est pourquoi au 19e siècle l'intelligentsia kachoube tenta d'éveiller chez les habitants un sentiment d'identité nationale. Une des manifestations essentielles de ces tentatives fut, bien sûr, celle de créer une langue kachoube littéraire standardisée, considérée à l'époque comme condition sine qua non pour parvenir à une conscience nationale. Ce fut le début d'incessantes controverses sur le caractère distinct ou non de la langue kachoube par rapport au polonais, aussi bien entre linguistes qu'entre hommes politiques. Deux opinions s'affrontaient chez les linguistes :
— les dialectes kachoubes et les dialectes polonais avaient constitué autrefois une seule et même branche du slave occidental; les dialectes kachoubes actuels étaient donc des variantes de dialectes polonais;
— les dialectes kachoubes constituaient une langue slave séparée, relique de l'ancienne population poméranienne.
[292]
La variété dialectale kachoube était grande, il était difficile de créer une langue kachoube littéraire standardisée. D'autre part, les langues standardisées utilisées couramment existaient déjà : le polonais à l'Église, l'allemand dans l'administration et à l'école. Enfin la reconnaissance des dialectes kachoubes comme langue indépendante était combattue par les patriotes polonais, qui y voyaient une menace pour l'unité polonaise future.
L'important pour notre étude de la linguistique spontanée est que l'idée que le kachoube était une langue distincte du polonais était soutenue par les autorités prussiennes. C'était en effet un argument crucial pour empêcher l'unification des Kachoubes et des Polonais en une seule entité linguistico-nationale, qui aurait été un obstacle à la politique visant à relier territorialement la Prusse orientale et la Prusse occidentale.
Après l'unification de l'Allemagne en 1871 fut mis en place le Kulturkampf, politique de germanisation à outrance menée par Bismarck : la construction d'un État allemand unifié requérait une lutte contre tous les facteurs de différenciation et d'hétérogénéité. Toutes les écoles autres qu'allemandes furent supprimées en Poméranie orientale, la pratique du polonais était interdite.
Mais l'État prussien avait intérêt à fabriquer les entités non allemandes les plus éparpillées possible. Ainsi, dans les instructions données aux officiers d'État civil chargés du recensement, il était clairement dit que le Plattdeutsch n'était pas une variété de langue, c'était de l'allemand, par conséquent les locuteurs du Plattdeutsch étaient des Allemands. Mais en Poméranie orientale à partir de 1890 il y eut trois colonnes pour la question du recensement qui portait sur la langue d'usage : soit allemand, soit polonais, soit kachoube : la liste des possibilité était fermée, toute indétermination était impossible. Les instructions aux recenseurs révèlent les termes de cette linguistique spontanée et de son caractère instrumental : le kachoube est une langue, alors que le Plattdeutsch n'en est pas, le kachoube est un tout différent du polonais, alors que le Plattdeutsch est une partie interne de l'allemand. Dans les instructions en vue du recensement prussien de 1910 on lit :
Les dialectes, comme par exemple le Plattdeutsch, ne forment pas de langue maternelle distincte. Mais les langues maternelles mazure et kachoube doivent être enregistrées comme telles et non pas comme polonais. (cité par Tesnière, 1933, p. 90) (10)
[293]
Mais, selon Tesnière (1933, p. 91), beaucoup de Kachoubes ont à cette époque adopté le polonais comme langue «littéraire» (=standardisée), et surtout l'ont déclarée comme langue d'usage dans les recensements, «parce qu'ils comprenaient qu'en se déclarant Kachoubes, ils faisaient le jeu de la propagande germanique» (ib.).
La conscience nationale apparaît bien ainsi séparée de la langue maternelle, ou langue du peuple. Cette non-concordance apparaît de façon encore plus criante dans les identités incertaines, dans les phénomènes d'assimilation ethnolinguistique : les Houtsoules sont des Valaques slovaquisés, les Szeklers sont des Turcs magyarisés de Transylvanie. Perd-on sa nation en même temps que sa langue? Mais que faire des situations intermédiaires?
2.2. Les statistiques linguistiques
Les négociateurs du Traité de Versailles se sont appuyés sur des raisonnements fondés sur les statistiques linguistiques. Or ces dernières sont extrêmement sujettes à caution. Bien des observateurs contemporains du Traité de Versailles en ont porté témoignage :
[294]
Le classement des peuples d'après leur langue ou dialecte ne saurait jamais être qu'approximatif, et l'on comprend fort bien que pendant la deuxième phase de la guerre, puis pendant les pourparlers de paix et la conclusion des traités, hommes d'État et diplomates aient souvent perdu tout espoir de résoudre les problèmes soumis à leurs discussions et à leurs décisions. C'est que le classement scientifique, établi d'après les règles générales découvertes par la linguistique, ne coïncide ni avec la situation territoriale des groupes délimités, situation qui est une conséquence des vicissitudes historiques, ni avec les besoins collectifs modernes, où les intérêts économiques cessent de plus en plus de correspondre à des intérêts nationaux, mais évoluent dans un plan qui leur est propre. [ ]
Le langage étant l'un des éléments fondamentaux de la vie sociale, comme moyen de communication entre les individus, et apparaissant d'autre part comme l'un des signes de différenciation les plus simples et les plus frappants, il a semblé de tout temps naturel et commode de classer les divers groupes humains en prenant cet élément pour base. Mais [ ] le langage est un produit de l'ingéniosité humaine, et non pas une donnée naturelle comme l'air ou le charbon; il participe de certains caractères de la vie, il évolue sans jamais être fixé, et par suite les catégories distinguées par la linguistique ne peuvent, elles aussi, être qu'approximatives. Phénomène vivant, le langage présente toutes les transitions d'un stade de départ à un stade d'arrivée, de sorte que si on examine tous les parlers d'un même pays, par exemple tous les dialectes d'oc, on constate que la transition de l'un à l'autre est, géographiquement et linguistiquement, presque insensible, et que la différence n'est appréciable pour un non-spécialiste qu'aux deux extrémités de la chaîne. (Van Gennep, 1922,p. 94-96)
Les témoignages de l'évidence sont peu fiables. Van Gennep note qu'en passant dans les confins polonais, il n'a jamais pu distinguer exactement les Ukrainiens des Polonais, parce qu'il s'ajoutait à la différence de langue une différence de religion : les catholiques ne parlant qu'ukrainien se disaient Polonais, et les Polonais convertis (par mariage, notamment) à la religion uniate se disaient Ukrainiens, alors qu'ils ne parlaient que le polonais (cf. Van Gennep, 1922, p. 100).
On réglait différemment, selon les pays, la question de la langue des enfants en bas-âge : quelle langue les enfants qui ne parlent pas étaient-ils supposés parler? Dans cette pensée du plein et du discontinu, on ne peut pas ne pas appartenir à un groupe. Même à l'intérieur de l'Autriche-Hongrie, avant la première guerre mondiale, en Autriche on enregistrait dans les statistiques la «langue d'usage» (Umgangsprache), alors qu'en Hongrie on enregistrait la «langue maternelle» (Muttersprache). Les pays qui avait adopté pour base de classification la langue maternelle utilisaient
[295]
au profit de la langue d'État la chance d'erreur éliminée par la Belgique (où les enfants de moins de deux ans étaient comptabilisés dans la catégorie des sourds-muets?). Ainsi, en Hongrie d'avant 1914, dans un ménage mixte, hongrois et roumain, hongrois et slovaque, quel que fût le sexe du conjoint non hongrois, l'enfant au-dessous de deux ans était automatiquement compté comme hongrois. Cette différence rend impossible la comparaison des statistiques ethnolinguistiques de l'Autriche et de la Hongrie d'avant la première guerre mondiale. Enfin pour les adultes, il avait été décrété que tout conjoint d'un Magyar ou d'une Magyare suivrait la nationalité de ceux-ci (cf. Van Gennep, 1936, p. 103-108).
Sans doute une langue apprise à l'école ou par nécessité professionnelle ne saurait plus compter comme «langue maternelle». C'est sans doute les réclamations des représentants des diverses nationalités de l'Empire qui ont forcé les statisticiens hongrois à donner une définition de la langue maternelle. On lit dans le commentaire du recensement hongrois de 1890 cette définition embarrassée :
C'est la langue qu'on apprend de sa mère, ou en d'autres termes, celle que l'on reconnaît pour telle, que l'on parle le mieux, ou le plus volontiers.
Le recensement de 1910 précise :
Il faut remarquer que, bien que la langue maternelle soit dans la plupart des cas identique avec celle que l'on parlait dans son enfance, et que l'on a apprise de sa mère, toutefois, il peut arriver que la langue maternelle de l'enfant est différente de celle de la mère, surtout lorsque l'enfant s'est approprié, soit à l'école, ou par d'autres rapports sociaux, soit par ce fait que ses parents ont une langue maternelle différente, une langue qui n'est pas celle de sa mère. (cité par Van Gennep, 1922, p. 109)
Quelles qu'en soient les modalités d'application pratique, ces déclarations et définitions sont l'application d'une sorte de droit naturel, ou principe naturel, ou plus exactement naturaliste : qui dit langue dit nation, donc, indépendamment de la conscience d'eux-mêmes que les gens peuvent avoir, on peut déterminer leur appartenance nationale en sachant ce qu'ils parlent.
[296]
Le principe naturaliste est ainsi systématiquement appliqué par Bismarck après la guerre de 1870 en Alsace-Lorraine (11). L'écrivain H. von Treitschke déclare ainsi en août 1871 :
Nous Allemands, qui connaissons la France et l'Allemagne, nous savons ce qui convient aux Alsaciens-Lorrains mieux que ces malheureux eux-mêmes [ ]. Nous voulons contre leur volonté leur rendre leur être propre. (cité dans Encycl. Universalis, art. Principe des nationalités)
En Transleithanie (partie hongroise de l'Empire austro-hongrois), les recensements hongrois de 1890 et 1910 reconnaissaient la religion juive mais pas la nationalité juive. Les Juifs étaient ainsi automatiquement inscrits comme Hongrois, ce qui gonflait les chiffres des Hongrois de 2% environ. Mais même la théorie objective de la nation s'appuyant sur les «déclarations» des gens était souvent prise en défaut. D'après J. Ancel (1936, p. 349) à propos de la côte dalmate dans le Royaume de Yougoslavie :
En 1933 un observateur impartial, l'Allemand März, s'arrête à la proportion de 2,7% d'Italiens, en incorporant parmi eux les Slaves qui se prévalent de la nationalité italienne soit pour échapper aux réformes agraires, soit pour se maintenir dans les affaires qui subsistent nombreuses entre les mains des Italiens. (Ancel, 1936, p. 349)
2.3. Les plébiscites
Le Traité de Versailles avait prévu de faire voter les habitants des régions où aucun consensus clair n'avait réussi à s'imposer sur l'appartenance nationale fondée sur la langue.
Le problème des Mazures va nous servir d'exemple. Les habitants de la Mazurie (12) parlaient un dialecte slave. Ils avaient été intégrés à la Prusse orientale au 14 ème siècle. Au moment où la réforme protestante était arrivée en Prusse orientale, ils étaient passés au luthéranisme, selon le principe bien connu : cujus regio ejus religio. Dès 1865 le ministre prussien de l'instruction publique avait établi une distinction entre le polonais
[287]
et le mazure. Les recensements de 1880 et de 1900 distinguent soigneusement, dans la question de la langue, le mazure du polonais. En 1905, les agents de recensement reçoivent l'ordre de compter comme Mazures «tous ceux qui peuvent être comptés comme tels». Or, en raison de son caractère protestant, le pays mazure ne se laissait gagner que lentement à «l'idée polonaise», qui, en Mazurie n'était qu'un lointain souvenir. De plus, en Pologne l'avenir était particulièrement sombre en cette année 1920, où la Pologne était envahie par l'armée rouge et semblait à deux doigts de sa perte. Le plébiscite du 11 juillet 1920 fut particulièrement net : la Pologne n'obtint que 8 000 voix contre 370 000 en faveur du rattachement à l'Allemagne (Prusse orientale). Mais en optant pour la citoyenneté allemande, les Mazures avaient-ils choisi la «nation» allemande? La politique de germanisation de la Mazurie fut en tout cas très forte : les villages étaient rebaptisés avec des noms allemands, l'Etat-civil refusait d'inscrire des enfants mazures sous des prénoms polonais.
3. Langue et nation, enjeux d'une querelle de noms
Le nom des langues introduit une discontinuité et une homogénéité dans une réalité fondamentalement hétérogène et continue. On n'adoptera pas ici une position nominaliste stricte, consistant à dire «est langue ce que j'appelle langue», qui ne peut conduire qu'au désespoir agnostique. Mais on doit s'en inspirer pour appliquer un doute méthodique aux objets de discours qu'on manipule, pour en étudier la construction et ne pas les prendre pour une nomenclature des choses.
A la différence du nom des oliviers et des citronniers, le nom de la langue est un enjeu de lutte, un enjeu symbolique extraordinaire, capable de fabriquer une ontologie. Nier le nom de la langue de l'autre revient à nier l'existence même de cette langue. En 1863 le Ministre russe de l'intérieur, Petr Valuev, édicte un règlement interdisant toute parution en ukrainien. Cette interdiction ne se présente pas comme le simple fait du Prince, elle est justifiée par une linguistique spontanée :
[298]
L'opinion de la majorité des Petits-Russiens prouve de façon concluante qu'il n'y a jamais eu de langue petit-russienne (13) distincte, qu'il n'y en a pas actuellement, et qu'il ne peut pas y en avoir. (cité par Sukiennicki, 1984, p. 37)
Néanmoins ce problème de nomination se retourne au début du 20e siècle au moment où l'Empire russe commence à donner des signes de faiblesse, ainsi qu'en témoigne ce texte de Meillet, où va apparaître tout l'enjeu du nom des langues :
S'il faisait partie d'un autre groupe indo-européen, le petit-russe passerait pour un dialecte peu différencié du russe; sur le domaine slave, où l'on est accoutumé à opérer avec des langues demeurées semblables les unes aux autres, on qualifie volontiers le petit-russe de langue autonome, et la section de langue et littérature russe de l'académie de Petrograd, composée de linguistes éminents et compétents, s'est prononcée en ce sens en 1905. En fait, un individu parlant petit-russe s'entend aisément avec un individu parlant grand-russe [?]. Néanmoins, il a été constitué en Galicie une langue écrite spéciale pour le petit-russe, et aussi différente qu'on a pu du grand-russe, parce qu'elle a été faite en Autriche et contre l'influence de l'Empire russe. Comme la plupart des hommes cultivés se servent du polonais en Galicie, du grand-russe dans les provinces russes, et que d'ailleurs le gouvernement tsariste a fait au mouvement petit-russe une forte opposition, cette langue n'a pas pris jusqu'ici une grande importance. Le plus célèbre écrivain du domaine petit-russe, Gogol, a écrit en grand-russe. (Meillet, 1918, p. 42).
Prenons maintenant le problème macédonien. La «langue macédonienne» est un cas d'école. Il n'y a guère d'exemples de réalité linguistique où le nom même ait été si controversé. Entre le traité de Berlin (1878) et la première guerre mondiale, la Macédoine faisait encore partie de l'Empire ottoman, alors que déjà la Serbie, la Bulgarie et la Grèce étaient des entités autonomes. Les nouveaux États balkaniques se disputaient cette région qui, juridiquement, faisaient partie de la Turquie. Une argumentation linguistique spontanée de type naturaliste fut avancée par les protagonistes (Bulgares, Serbes et Grecs) qui revendiquaient le territoire.
Dans l'Empire ottoman on ne différenciait pas les gens selon la langue ou la «nationalité», mais selon leur religion. L'Empire ottoman
[299]
avait accordé une relative autonomie aux Chrétiens orthodoxes : le urum millet. Un millet était une communauté religieuse autonome (14). Tout ce qui était chrétien orthodoxe était considéré comme roumi. Au fur et à mesure que l'Empire ottoman entrait en décadence, il était obligé de faire des concessions à des nationalités qui réclamaient leur autonomie. C'est ainsi qu'en 1870 fut accordé le bugar millet, instituant l'autonomie des Bulgares par rapport aux autres Orthodoxes. C'est là que les choses commencent à se compliquer fortement, à cause du double critère de classification. Les slavophones de Macédoine, par rejet des Grecs, s'affiliaient à l'Église bulgare, et étaient ainsi automatiquement considérés comme Bulgares (au sens religieux) par les Turcs, et Bulgares au sens ethnique par les Bulgares de Bulgarie. Mais ceux qui continuaient de fréquenter l'Église grecque étaient considérés comme des Grecs par les Grecs, même s'ils ne connaissaient pas un mot de grec. Lorsque le moment vint de réclamer le territoire de la Macédoine, lors du«partage des dépouilles» de l'Empire ottoman, les Bulgares affirmèrent que les dialectes macédoniens étaient du pur bulgare, les Serbes qu'ils étaient indifférenciés mais proches du serbe, et les Grecs qu'il s'agissait de parlers grecs fortement slavisés. En août 1946 fut créée dans la Yougoslavie titiste une langue macédonienne standardisée, aux traits les plus différents possibles du bulgare, pour couper court aux revendications territoriales bulgares sur la Macédoine (15) .
La région balkanique pose à l'heure actuelle des problèmes identiques à ceux de l'Europe centrale au début du 20e siècle : le nom des langues y a un enjeu ontologique, facteur d'irrédentisme. Ainsi l'albanais parlé dans les régions de Grèce non contiguës au territoire de l'État albanais est appelé en Grèce (par les linguistes) arvanitika, alors que l'albanais d'Albanie est dénommé alvanika, ce qui implique que ce sont des entités différentes, et non des variétés d'une même langue. Les conséquences pratiques (pour les manuels d'enseignement, par exemple) sont claires. Or la pratique courante en dehors de la Grèce est de considérer l'albanais parlé en Grèce comme une variante de l'albanais d'Albanie. De même, il existe en Grèce des variantes méridionales de dialectes romans orientaux, apparentés au roumain de Roumanie, connus sous le nom d'aroumain dans le Pinde
[300]
et en Thessalie, et megleno-roumain en Macédoine grecque, qui sont assez différents du roumain pour que l'intercompréhension soit très difficile. Au début du siècle, le gouvernement roumain avait établi des écoles à enseignement en roumain dans des territoires actuellement grecs mais qui étaient alors sous juridiction ottomane, en s'abritant derrière l'argument que ces dialectes étaient en fait des variétés de roumain. Mais depuis 1920 les gouvernements grecs successifs refusent cette pratique, et appellent ces parlers vlachika (valaque). N'ayant aucune possibilité de s'appuyer sur la langue roumaine standardisée (avec ses manuels et ses dictionnaires), le valaque devient une vraie langue minoritaire, donc vulnérable (sur les problème des langues minoritaires en Grèce, cf. Trudgill, 1992).
On voit que ce qui pose problème, dans une proposition de type «le macédonien c'est du bulgare», ou «le X c'est du Y», est toujours le verbe être. Avec ce verbe on peut faire de l'autre avec du même (polonais et kachoube), on peut également faire du même avec de l'autre (macédonien et bulgare, ukrainien et russe). La différence entre le même et l'autre peut ainsi ne pas être une question d'observation, mais bien de construction discursive. Cela ne signifie en rien qu'elle est sans objet, mais que ses conséquences pratiques ont une assise nominale. Ainsi, si l'on considère que «les Slaves» parlent des variantes dialectales d'une seule et même langue, les thèses panslavistes sont fondées, et les Slaves forment une seule nation, qu'il est légitime de vouloir rassembler en un seul État. Si, au contraire, on considère que ces langues sont différentes, les thèses panslavistes ne peuvent recevoir de justification.
Conclusion
Je terminerai en disant qu'il peut y avoir d'autres façons de définir une nation que d'aller voir qui parle quoi.
L'indépendance nationale et la vie des minorités sont un problème sérieux, digne d'investigations poussées, qui devrait être mieux connu en Occident. Mais ce n'est pas un problème à résoudre par une argumentation linguistique, à moins que l'on ne s'occupe du volontarisme linguistique, qui, lui, a fabriqué des coupures de façon, sinon artificielle, du moins politique.
[301]
On peut maintenant reconstituer le modèle de cette linguistique spontanée, fondé sur les assertions suivantes :
- la langue est une entité homogène, elle appartient à une nation:
- il n'y a pas de langue sans nation, donc pas de nation sans langue, (encore une fois la Suisse n'a pas de place dans ce type de pensée);
- la langue est la marque d'une ethnie, donc linguistique et ethnologie vont de pair;
- les dialectes sont des variations du même, donc doivent être ignorés et éliminés;
- les autres langues sont des variantes de l'Autre, donc doivent être expulsées;
- les langues reflètent l'âme de leur peuple;
- leur singularité absolue est irréductible;
- les langues sont des objets naturels, cartographiables, comme la culture des oliviers;
- mais en même temps une langue se construit et se normalise.
Ce qui précède porte à penser, au contraire, que langues et nations sont des entités nominales des objets de discours qui entrent dans des pratiques discursives. Le parcours de ces différentes pratiques peut faire l'objet d'une étude comparative fort instructive, susceptible de nous éclairer sur des enjeux pratiques parfaitement concrets.
Ce parcours des arguments naturalistes, ou «théorie objective» de la nation nous permet alors de reprendre l'argumentation inverse, ou «théorie subjective», dont on trouvera l'expression la plus claire dans le célèbre texte de Renan :
L'homme n'appartient ni à sa langue ni à sa race : il n'appartient qu'à lui-même, car c'est un être libre, c'est un être moral. [ ] Au-dessus de la langue, de la race, des frontières naturelles, de la géographie, nous plaçons le consentement des populations, quels que soient leur langue, leur race, leur culte. (Préface aux Discours et conférences, 1887, in Renan, 1992, p. 57-58)
NOTES
(1) Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par intercompréhension. Aucune réponse claire n'a été jusqu'à présent apportée au problème de savoir s'il y avait intercompréhension entre l'occitan parlé à Bordeaux et l'occitan parlé à Nice. Est-on dans le même ou dans le différent? (retour texte)
(2) Cf. P. Garde, 1992, p. 45.(retour texte)
(3) Cf., dans ce recueil, l'article de B. Ferencuhová.(retour texte)
(4) Lorsque W. Wilson arriva en Europe pour les délibérations du Conseil des Quatre, il n'avait, visiblement, aucune idée de la situation réelle du problème des nationalités. S. Freud a étudié ce cas étonnant dans un livre entièrement consacré à la personnalité du Président Wilson (Freud, 1990).(retour texte)
(5) et que l'on ne peut pas appeler langue littéraire, qui serait comprise en français comme «langue de la littérature». (retour texte)
(6) Signalons toutefois que cet atlas a été fait à la fin des années 70, à une époque où l'on pouvait ne pas se rendre bien compte des rapports entre les ensembles serbe et croate. Mais une idée fixe est à la base de ce travail : une nation se définit et se délimite par sa langue. Nul critère de délimitation entre les langues n'est toutefois donné : l'existence des langues en tant qu'objets discontinus est pour F. Fontan un fait d'évidence. (retour texte)
(7) Mais sur cette carte il y a une discontinuité du territoire magyarophone entre la Hongrie et la Transylvanie. (retour texte)
(8) Cf. E. Renan : «La nation, une idée claire en apparence, mais qui prête aux plus dangereux malentendus» (Renan, 1992, p. 37).(retour texte)
(9) Dans cette partie sur le couple langue-nation kachoube, on s'est inspiré du livre de Van Gennep, 1922.(retour texte)
(10) «Dialekte, z. B. Plattdeutsch, gelten nicht als besondere Sprachen. Die masurische und kassubische Muttersprache ist als solche nicht als polnisch zu bezeichen» (Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 240, Berlin, 1915, p. 8). Pourtant certains fonctionnaires prussiens ont fait part de leur embarras. L'Office royal de statistique a publié dans l'Introduction aux recensements quinquennaux d'après la langue maternelle des extraits des rapports des fonctionnaires enquêteurs. Celui d'Allenstein (Mazurie), à qui l'on demandait de faire spécifier avec soin par ses agents et les habitants la distinction, exigée par Berlin, entre le polonais et le mazure, écrivait en 1905 : «En ce qui concerne cette distinction, on est souvent embarrassé pour déterminer si l'idiome mazure est une langue maternelle ou si c'est seulement un dialecte polonais». Le président de la région de Dantzig se plaignait également des Kachoubes, «parce qu'ils se refusaient à inscrire le kachoube comme langue maternelle, mais préféraient inscrire le polonais» il conseillait aux fonctionnaires de Berlin de laisser de côté dans la prochaine statistique la rubrique «kachoube, puisque kachoube et polonais ont le même sens» (Preussische Statistik für das Jahr 1905, IIIer Teil, Muttersprache, Berlin, 1908, p. XXVII, cité par Van Gennep, 1922, p. 113-114).(retour texte)
(11) ce qui donne lieu à la polémique entre E, Renan et D.-F. Strauss sur la définition de la nation, cf. Renan, 1992. (retour texte)
(12) connue dans le monde de la danse par la mazurka.(retour texte)
(13) Le «petit-russien» ou «petit-russe» était la dénomination couramment utilisée en Russie au 19e siècle pour désigner l'ukrainien. Elle est encore utilisée par N. Troubetzkoy dans les années 1930.(retour texte)
(14) Urum = roumi, = Romain, terme qui désignait les descendants de l'Empire byzantin, c'est-à-dire les Grecs.(retour texte)
(15) Sur la question du nom de la langue macédonienne, cf. Sériot, 1997.(retour texte)
-------------
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
— ANCEL Jacques (1936) : Manuel géographique de politique européenne, t. 1 : L'Europe centrale, Paris : Delagrave.
— AUROUX Sylvain et al. (1985) : La linguistique fantastique, Paris : Clims / Denoël.
— BAGGIONI Daniel (1986) : «Préhistoire de la glottopolitique dans la linguistique européenne, de Herder au Cercle de Prague», Langages, n° 83, p. 35-51.
— BEAUVOIS Daniel (1988) : Les confins de l'ancienne Pologne, Lille : Presses Universitaires de Lille.
— BEN VAUTIER (1988) : Préface, in FONTAN (1988), p.4-5.
— DUMONT Louis (1985) : «Le peuple et la nation chez Herder et Fichte», in DUMONT Louis : Essais sur l'individualisme, Paris : Seuil, p. 134-151.
— FONTAN François (1988) : Atlas des futures nations du monde, Nice : Atelier d'impression, 44 p.
— FREUD Sigmund (1990) : Le Président Thomas Woodrow Wilson, Paris : Payot.
— IVANOFF J. (1919) : Les Bulgares devant le Congrès de la Paix (Documents historiques, ethnographiques et diplomatiques), Berne : Paul Haupt (2e éd.).
— LANSING Robert (1921) : The Peace Negociations. A Personal Narrative, Boston.
— MEILLET Antoine (1918) : Les langues dans l'Europe nouvelle. Paris : Payot.
— RATZEL Friedrich (1898) : Deutschland. Einführung in die Heimatkunde, Berlin - Leipzig : de Gruyter.
— RENAN Ernest (1992) : «Qu'est-ce qu'une nation? (Conférence faite en Sorbonne, le 11 mars 1882)», in RENAN Ernest : Qu'est-ce qu'une nation?, Paris : Presses Pocket, p.37-58.
— SERIOT Patrick (1997) : «Faut-il que les langues aient un nom? Le cas du macédonien», in TABOURET-KELLER A. (éd.) : Le nom des langues. Les enjeux de la nomination des langues, Louvain : Peeters, p. 167-190.
— STALINE Joseph (1913) : Marksiszm i nacional’nyj vopros, trad. fr. : Le marxisme et la question nationale, Paris : Éditions du Centenaire, 1978.
— SUKIENNICKI Wiktor (1984) : East Central Europe During World War I, New York.
— TESNIERE Lucien (1933) : «La lutte des langues en Prusse orientale», in La Pologne et la Prusse orientale, Paris : Société française de librairie Gebethner et Wolf, p. 48-97.
— TRUGDGILL Peter (1992) : «The Ausbau Sociolinguistics of Greek as a Minority and Majority Language», in Proceedings of the 6th International Symposium on the Description and/or Comparison of English and Greek, M. MAKRI-TSILIPAKOU (ed.), Thessaloniki : Aristotle University, p. 213-235.
— VAN GENNEP A. (1922) : Traité comparatif des nationalités. t. 1 : Les éléments extérieurs de la nationalité, Paris : Payot.
------------------
Annexe : «Propositions pour un programme international ethniste» (extraits), de François Fontan (Fontan, 1988, p. 43-44, texte écrit en 1961)
A) Détermination des nations
1- Une étude de l'état linguistique actuel de l'humanité doit être faite, afin d'établir la liste des nations à partir du principe d'intercompréhension. Constitue une langue nationale :
- Toute langue commune ou groupe de parlers actuellement usités par un groupe humain occupant un territoire déterminé.
- Toute langue actuellement usitée par une ethnie ayant autrefois occupé un territoire, si cet idiome a été usité sans interruption et s'il n'a pas évolué depuis lors en de nouvelles langues nationales.
2- Le principe de l'intercompréhension sera interprété largement dans le cas de populations très peu nombreuses, ainsi que dans le cas de dialectes intermédiaires n'offrant pas de caractéristiques propres de quelque importance.
[ ]
B) Frontières des nations
4- La délimitation territoriale entre les nations devra se faire suivant l'appartenance linguistique de la population lorsque cette appartenance est unique et stable.
5- Lorsque cette appartenance a changé partiellement sur un territoire donné par assimilation, cette assimilation sera tenue pour nulle. Lorsque cette appartenance a changé totalement, il en sera de même, sauf si l'assimilation est ancienne (datant d'au moins deux ou trois siècles) ou si elle concerne une nation disparue.
6- Lorsque cette appartenance a changé par immigration et substitution récentes, cette substitution sera également nulle sauf si l'ancienne ethnie était de très faible densité : dans ce dernier cas, le territoire est partagé en rapport avec l'importance numérique des deux populations ainsi qu'en tenant compte du droit de priorité. Lorsqu'un territoire est habité de longue date par des nationalités différentes, il sera partagé proportionnellement à leur importance numérique.
7. Des échanges de territoires et de populations seront effectués lorsque cela sera nécessaire pour restaurer l'unité territoriale et humaine d'une nation [ ]
C) Objectifs culturels
10- Dans chaque nationalité, l'unité linguistique sera achevée ou restaurée. Le passage du stade «ensemble de parlers» à celui de «langue commune unique» s'effectuera partout où ce n'est pas encore fait.
Dans ce but on devra adopter les formes phonétiques et grammaticales des dialectes centraux, modifiés par des emprunts aux divers dialectes périphériques. On préférera les formes originales (par rapport à celles des autres langues), dans la mesure où elles sont suffisamment répandues; ce deuxième critère sera seul retenu en ce qui concerne la sélection lexicale. [ ]
12- Dans le territoire de chaque nation, la langue nationale sera la seule langue de l'administration, de la presse et de l'enseignement.
D) Objectifs politiques et économiques
14- Chaque nation doit former un État unifié et souverain, jouissant de l'indépendance politique et de l'égalité juridique vis-à-vis des autres nations.
Par État il faut entendre ici non pas une certaine structure interne, mais un organisme réglant tous les problèmes que posent les rapports avec les autres nations. L'État doit être dirigé par des forces réellement ethnistes. Tout groupement ayant des objectifs antinationaux, ou pouvant en avoir parce que dépendant de directions étrangères, de même que tout groupement ayant des objectifs impérialistes, doit être exclu de toute possibilité de parvenir au pouvoir. [ ]